
⏳ Temps de lecture : 2 minutes
Il suffit de traverser quelques kilomètres pour que le français prenne des airs un peu différents. En Belgique, et aussi en Suisse, les chiffres s’énoncent parfois avec une simplicité déconcertante : septante, nonante, voire huitante dans certaines régions. Et pendant ce temps, en France, on continue à jongler avec des soixante-dix, quatre-vingts et quatre-vingt-dix qui font grimacer bien des élèves. Mais pourquoi ces différences ? Une simple bizarrerie régionale ? Pas du tout. Ce sont en réalité des choix linguistiques et historiques profonds.
Le bon sens belge : le système décimal
Les Belges n’ont rien inventé, ils ont simplement gardé ce que le latin leur avait offert : un système décimal clair et linéaire. Septante, octante (même si ce dernier a disparu), nonante… tout découle directement des formes latines septuaginta, octoginta, nonaginta. Ce n’est donc pas une fantaisie moderne, mais un héritage du français ancien que la Belgique a préféré conserver. Un choix validé au XIXe siècle, quand l’enseignement s’est structuré autour d’une norme plus cohérente et plus pédagogique.
Derrière ce maintien du système décimal, il y a une volonté claire : simplifier l’apprentissage, et ne pas alourdir inutilement une langue déjà pleine d’exceptions. Une logique qui a séduit aussi certains enseignants en Afrique francophone, où septante et nonante s’imposent parfois comme des alternatives plus accessibles.
La complexité à la française : un héritage historique
Et la France, dans tout ça ? Eh bien, elle a préféré conserver une forme plus alambiquée, héritée du système vigésimal, basé sur des multiples de vingt. Soixante-dix, c’est donc 60 + 10 ; quatre-vingts, c’est 4 x 20… et quatre-vingt-dix, c’est 4 x 20 + 10. Pas de quoi faire rêver les élèves de CE2.
Cette construction n’est pas un caprice, mais le fruit d’une tradition médiévale, influencée notamment par les Gaulois et d’autres peuples du nord. Elle a été entérinée par l’Académie française au XVIIe siècle, puis renforcée par la centralisation linguistique autour de Paris. Le français de la capitale est devenu la norme, balayant progressivement les autres usages.
Comme le rappelle le linguiste Bernard Cerquiglini, c’est bien le français parisien qui a imposé ses règles, parfois au mépris de la logique. Ainsi, les “septante” et “nonante” ont été progressivement relégués au rang de curiosités régionales.
Une langue, plusieurs identités
Mais le français, ce n’est pas qu’une langue figée. C’est aussi une mosaïque d’usages et d’influences locales. En Belgique, par exemple, on ne dit pas “serviette” mais “essuie”, on parle de “GSM” au lieu de “portable”, et on termine certaines phrases par “une fois”, clin d’œil typique de l’accent bruxellois.
Ce français belge, loin d’être un sous-français, est reconnu, enseigné et utilisé dans tous les domaines officiels. Le Conseil de la langue française de Belgique le rappelle : il a sa norme propre, tout en restant compréhensible par les autres francophones. Une richesse pour la francophonie, qui prouve que la diversité linguistique est une force, pas un obstacle.
Une logique qui séduit au-delà des frontières
Mathématiquement, septante est plus simple. Pédagogiquement aussi. On passe de 60 à 70, de 70 à 80… sans gymnastique mentale. C’est un atout pour les enfants, mais aussi pour les apprenants étrangers, qui peinent souvent à décrypter les quatre-vingt-dix et autres énigmes chiffrées.
Certains professeurs français l’avouent sans détour : ce système rend l’enseignement des nombres inutilement complexe. Alors, faut-il abandonner soixante-dix au profit de septante ? Difficile, tant l’habitude est ancrée. Mais une chose est sûre : la clarté des Belges a de quoi faire réfléchir.
































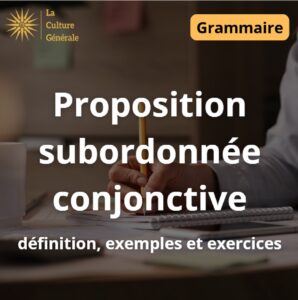




Laisser un commentaire