La révolution des technologies de l’information et de la communication (TIC) à partir des années 1980 a suscité de nombreux espoirs chez les économistes : peut-être s’agissait-il, en effet, du mouvement qui allait impulser le renouveau de la croissance des pays du nord. Bien plus, ces nouvelles technologies allaient fondamentalement révolutionner le fonctionnement de nos organisations – les entreprises, les services publics, les associations… – mais également notre rapport au travail et au monde.
Dès lors, de nombreuses études se sont penchées sur l’impact des TIC sur la croissance, la productivité ou encore l’emploi. Comme ce secteur particulièrement prometteur est également très intensif en capital humain, les économistes se sont particulièrement intéressés à la question des connaissances et de la formation, donnant ainsi naissance à une nouvelle branche de leur discipline, appelée « économie de la connaissance. » Celle-ci, née aux Etats-Unis, notamment à l’Université de Stanford, dans les années 1980, est désormais enseignée à travers le monde.
Le renouveau des théories de la croissance économique

Le modèle de Robert Solow
Le modèle standard de la croissance du produit intérieur brut (PIB) a été élaboré par Robert Solow en 1956. Elle prévoit la division de cette croissance en deux composantes : l’une expliquée par l’augmentation quantitative des facteurs de production, soit le travail et le capital (ce qui constitue une simplification de la réalité), et l’autre exogène, baptisée « résidu de Solow » et souvent assimilée au progrès technique ou à la productivité globale des facteurs. L’économie de la connaissance est précisément née de la volonté de comprendre les variables influençant ce résidu et son impact sur le PIB.
Elle est d’autant plus importante qu’à long terme, le rendement décroissant du capital épuise le potentiel de croissance issue de l’accumulation de ce facteur. Dans le même temps, une expansion économique fondée sur la seule croissance du facteur travail n’augmente pas la richesse par habitant si elle est seulement due à un accroissement démographique. À l’inverse, si elle procède d’une augmentation du nombre d’heures de travail par personne, le PIB par habitant progresse mais leur bien-être peut diminuer. A partir des années 1970, dans un contexte de ralentissement marqué de la croissance des pays développés, ces questions deviennent fondamentales.
L’importance reconnue du progrès technique
C’est l’économiste Paul Romer, dans un article intitulé Increasing Returns and Long Run Growth (1986), qui, le premier, modifie le modèle de Solow en faisant du progrès technique un facteur endogène et non plus exogène de l’augmentation du PIB. Selon lui, en effet, l’accumulation de capital produit aussi une amélioration de la productivité des facteurs grâce à l’élévation du niveau de connaissance d’une économie, grâce à un phénomène de learning-by-doing. Romer est ensuite suivi de Robert Lucas en 1988 qui pointe l’importance de l’augmentation du capital humain par le biais de l’éducation et de la formation dans l’accroissement de productivité globale des facteurs. Ces économistes introduisent ainsi une théorie de la croissance dite « endogène ».
L’innovation ou le nouveau paradigme de la science économique

Succès de ” l’économie de la connaissance”
Ces théories rencontrent rapidement un franc succès, notamment car elles répondent à des problèmes concrets que doivent alors affronter les pays développés. En effet, disposant d’une forte intensité capitalistique et généralement caractérisés par un faible accroissement démographique (à l’exception des États-Unis, du Canada ou de l’Australie), ces pays ne peuvent guère compter que sur l’accroissement de la productivité afin de croître. Or, comme le notent les économistes Philippe Aghion et Peter Howitt, celle-ci ne peut venir que de l’innovation. Ces économies proches de la frontière technologique, de fait, auraient épuisé leur potentiel de croissance issu de l’imitation.
Une correlation entre richesse et recherche…
Cette situation impose donc aux États du nord de soutenir l’innovation, qui n’est rendue possible que par le capital humain et la connaissance. Ainsi, dans les années 2000, les pays connaissant les taux de croissance les plus élevés sont souvent ceux qui dépensent le plus en recherche et en développement : les États-Unis consacrent ainsi 2,8 % de son PIB à ce secteur pour un taux de croissance de 2,7 % entre 2001 et 2007. La Suède fait mieux encore avec plus de 3 % de croissance pour environ 3,5 % de son PIB consacrée à la R et D.
…sans causalité nécessaire ou absolue.
Cette corrélation n’est toutefois pas absolue. En effet, les États-Unis doivent une partie de leur forte croissance à l’expansion continue de leur population. Pire encore, le Japon, qui dépense plus de 3 % de son PIB en R&D, connaît une faible croissance depuis le début des années 1990. Pour important que soit la recherche, celle-ci ne suffit pas à assurer à tous les pays un développement économique satisfaisant.
Différents facteurs de l’innovation
En outre, l’innovation ne dépend pas uniquement du montant des dépenses en R&D, mais aussi de leur qualité, de l’environnement réglementaire au sein du pays, de la protection de la propriété intellectuelle ou encore du coût relatif des facteurs de production : une entreprise qui a largement accès à des facteurs peu onéreux n’est en effet pas incitée à innover (c’est ainsi qu’aux Etats-Unis, les cultivateurs de blé, fortement subventionnés, sont peu productifs, du fait d’un manque d’encouragement à mieux utiliser leurs facteurs de production). Dans tous les cas, il apparaît cependant nécessaire pour une économie d’investir dans son capital humain.
Au cœur de l’économie de la connaissance, la révolution des TIC

L’économie de la connaissance et la révolution technologique
Outre le ralentissement de la croissance des pays du nord, un autre phénomène marquant des années 1980 explique la montée en puissance de l’économie de la connaissance. Il s’agit de la révolution des nouvelles technologies, à partir de la Silicon Valley en Californie, avec en premier lieu le développement d’internet. Celui-ci serait en particulier à l’origine de la forte croissance économique américaine à partir de cette époque, par rapport à celle des pays européens moins rapides à adopter les TIC : alors que l’Europe de l’ouest rattrapait les États-Unis jusqu’en 1980, l’écart entre les deux régions s’est accru durant les décennies suivantes.
L’impact positif des TIC
Les TIC ont un impact positif sur la productivité du travail, à la fois car il s’agit d’un secteur où elle est forte et car il agit également sur les autres secteurs de l’économie. En effet, les nouvelles technologies créent des effets de réseau qui favorisent les économies d’échelle tout en facilitant un processus d’augmentation du ratio capital/travail (« capital deepening »). En revanche, le progrès technique peut provoquer une certaine polarisation du marché du travail entre des travailleurs hautement qualifiés qui en bénéficieraient et des travailleurs moins bien formés qui perdraient leur compétitivité. D’où l’importance, dans une économie dominée par les TIC, de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle.
Une nouvelle révolution industrielle ?
À noter toutefois que la question de savoir si le développement des TIC constitue une nouvelle révolution industrielle comparable aux précédentes ne suscite toujours pas de consensus. Robert Gordon estime ainsi qu’une stagnation séculaire attend les pays développés au XXIe siècle à cause d’un épuisement rapide de la croissance due aux nouvelles technologies.
C’est le phénomène des low hanging fruits : les innovations aux rendements les plus élevés sont apparues les premières. Désormais, il sera plus difficile de trouver des gisements de productivité et de croissance comparables. À l’inverse, de nombreux observateurs estiment que l’humanité est à l’aube de changements majeurs introduits par une nouvelle vague de technologies innovantes comprenant notamment le big data, l’imprimante 3D et peut-être même l’intelligence artificielle.
L’économie de la connaissance et la mondialisation

Les pays émergents entrent en jeu
L’économie de la connaissance a d’abord essentiellement concerné les pays développés, dits proches de la frontière technologique, celle-ci étant généralement située aux États-Unis. À l’inverse, les pays émergents pouvaient continuer à fortement croître en favorisant d’autres leviers plus classiques comme l’augmentation du facteur travail par une augmentation de leur taux d’emploi et l’accumulation de capital physique par de lourds investissements.
Pourtant, petit à petit, le nombre de joueurs dans la nouvelle économie augmente : dès les années 1970, le Japon est un pays en pointe dans de nombreux secteurs à forte valeur ajoutée. Dans les années 1990, c’est la Corée du Sud qui rejoint le club des nations développées qui, d’ailleurs, comprend alors d’autres pays asiatiques de plus petites dimensions tels que Singapour ou Taïwan. Aujourd’hui, la Chine dépense 2 % de son PIB en R&D, soit plus que la moyenne de l’Union européenne. Par ailleurs, ces pays devancent désormais les nations européennes au classement PISA mesurant les compétences des écoliers de ces différents pays. Incontestablement, le marché du savoir devient de plus en plus concurrentiel.
Économie de la connaissance, économie de la compétition
La compétition est également rude pour attirer les meilleurs éléments étrangers dans son propre pays, en premier lieu les étudiants. Les États-Unis, grâce à des universités de classe mondiale, conservent une marge d’avance dans ce domaine, mais d’autres États mènent une politique volontariste en la matière, comme l’Australie ou le Royaume-Uni. La France tente elle aussi d’attirer des talents sur son territoire même si le rapport Ramanantsoa de 2016 pointe, à cet égard, plusieurs faiblesses qui affectent l’attractivité de son modèle d’enseignement supérieur. Sont notamment en cause une absence de vision dans ce domaine, la faible lisibilité du système universitaire français pour les étrangers ou encore le manque de ressources de nombreux établissements, incapables de rivaliser avec les meilleures universités mondiales.
Diffuser les connaissances

La connaissance, un bien public
Thomas Jefferson disait « Celui qui reçoit une idée de moi reçoit un savoir sans diminuer le mien ; tout comme celui qui allume sa bougie à la mienne reçoit la lumière sans me plonger dans la pénombre ». Ce faisant, il exprimant déjà l’idée selon laquelle la science était un bien public non-rival (son utilisation par un agent n’exclut pas que d’autres puissent également y avoir accès) et générateur d’externalités positives. Autrement dit, le bénéfice social de la connaissance excède son bénéfice privé. Cela justifie donc une volonté de la diffuser le plus largement possible.
Des pôles pour l’économie de la connaissance
A cet égard, dès 1890 dans Principles of economics, Alfred Marshall notait que la concentration des activités était souvent favorable à la croissance. Cette idée se retrouve un siècle plus tard chez l’économiste Paul Krugman qui lie cela à plusieurs facteurs : la présence locale d’un main d’œuvre parfaitement adaptée à ces activités, l’existence de sous-traitants ou de services bénéfiques à toutes les entreprises présentes dans le secteur mais aussi à la diffusion du savoir que permet cette concentration. C’est en particulier ce phénomène que l’on retrouve dans la Silicon Valley, d’autant que celle-ci dispose avec Stanford de l’une des universités les plus innovantes de la planète.
Cela semble justifier les politiques visant à constituer des pôles sectoriels constitués d’établissements d’enseignement, de centres de recherche, de complexes industriels et d’entreprises assurant le financement de l’innovation (banque mais surtout capital-investissement et capital-risque). C’est notamment ce que la France cherche à accomplir depuis le milieu des années 2000 avec ses pôles de compétitivité, dont le plus bel exemple est celui du plateau de Saclay.
Une économie de la connaissance sans propriété intellectuelle ?
Pour autant, assurer une diffusion illimitée d’un savoir innovant peut aussi avoir son revers. En effet, puisque tous pourraient en bénéficier, personne n’aurait alors particulièrement intérêt à le découvrir. C’est pourquoi les économistes préconisent généralement de faire jouir l’innovateur d’avantages constituant une rente temporaire.
Le droit de la propriété intellectuelle est précisément censé résoudre ce problème en permettant à un agent ou une entreprise de déposer des brevets sur ses innovations.
Ce système a toutefois été critiqué, y compris par des experts de renom comme Joseph Stiglitz, prix Nobel d’économie en 2001. Selon celui-ci, les brevets entravent souvent la diffusion dans les pays émergents ou peu développés de biens ou de savoirs qui pourraient significativement y améliorer la qualité de vie. Stiglitz prend notamment l’exemple de l’industrie pharmaceutique, de nombreux médicaments restant selon lui trop difficiles d’accès dans les pays du sud. Il ne propose toutefois pas d’abandonner le système du brevet mais plutôt de le réformer de l’adapter aux différents pays ou secteurs pour le rendre plus juste.
L’économie de la connaissance : une solution miracle à tous nos problèmes économiques ?
L’économie de la connaissance dans une stratégie de croissance globale
De nombreux économistes estiment que l’innovation, l’investissement dans le capital humain et la diffusion des savoirs vont apporter des solutions à de nombreux problèmes qui se posent à l’heure actuelle, que ce soit le ralentissement de la croissance économique, le réchauffement climatique ou l’épuisement des ressources naturelles. À l’inverse, sans innovations de grande ampleur, seule une politique malthusienne sera possible sur une planète qui pourrait compter entre 10 et 15 milliards d’habitants en 2100.
Si les investissements dans l’économie de la connaissance sont incontestablement nécessaires à l’heure actuelle, ils doivent s’insérer dans une stratégie de croissance globale. Ainsi, les politiques de stabilisation macroéconomique – budgétaires et monétaires – conservent par exemple toute leur pertinence, car en période de crise, les entreprises et les pouvoirs publics disposent de moins de ressources à consacrer à l’innovation (Aghion et al, 2008).
En même temps, le rôle de l’État n’est pas uniquement de produire directement de la connaissance comme bien public mais aussi d’inciter les acteurs privés à le faire. Cela peut par exemple passer par une politique visant à garantir la concurrence sur les marchés des biens et services, afin d’empêcher l’existence de rentes de monopole (différente de la rente d’innovation) qui n’encouragent guère à investir dans le progrès technique ou l’augmentation de la productivité.
Des gagnants et des perdants dans l’économie de la connaissance
Surtout, l’économie de la connaissance telle qu’elle s’est développée jusqu’à présent semble avoir produit des gagnants et des perdants, ces derniers se trouvant bien souvent parmi les travailleurs les moins qualifiés. Ces évolutions peuvent affecter le capital social au sein de nos sociétés, nuisant à notre croissance et créant des risques d’instabilité. Elles illustrent la nécessité de garantir au maximum de personnes une éducation de qualité et adaptée au marché du travail actuel.
Des réformes de l’éducation et de la formation nécessaires
En outre, l’accélération apparente du progrès technique rend d’autant plus importante la formation tout au long de la vie, ce qui doit susciter une réflexion sur l’organisation de nos systèmes éducatifs. À cet égard, on note déjà des évolutions intéressantes comme le développement de l’executive education (formations universitaires pour les cadres expérimentés, souvent à mi-temps) ou la multiplication des MOOC (massive open online course), formations en ligne de plus en plus souvent proposées par des universités prestigieuses.
Économie de la connaissance, économie du futur
Quant à la recherche économique sur l’innovation et le savoir, elle devrait se poursuivre et même s’accélérer dans les années à venir. Elle répond en effet à une véritable demande de l’économie, de nombreux agents souhaitant avoir une idée plus claire de l’impact des nouvelles technologies sur les marchés qui les intéressent. Ainsi, le président de McKinsey, Dominic Barton, souligne souvent que la majorité des dirigeants d’entreprise avec lesquels il communique estiment que le progrès technologique sera la principale force disruptive dans leur secteur dans les années ou les décennies à venir.
Bibliographie
- Paul Romer, Increasing returns and long-run growth
- Philippe Aghion, Gilbert Cette et Elie Cohen, Changer de modèle
- Philippe Aghion, Peter Howitt, L’économie de la croissance
- Dominique Foray, L’économie de la connaissance
- Joseph Stiglitz, Creating a learning society









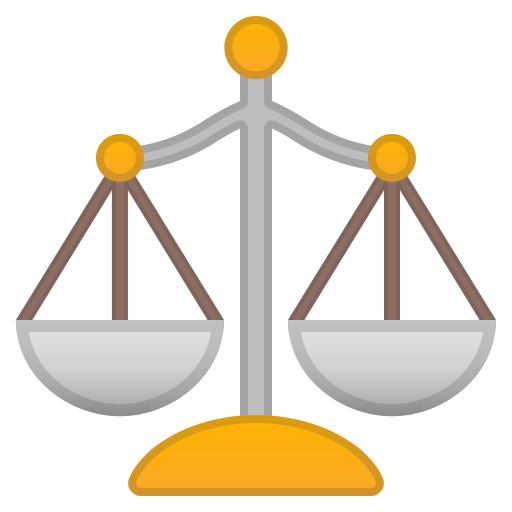









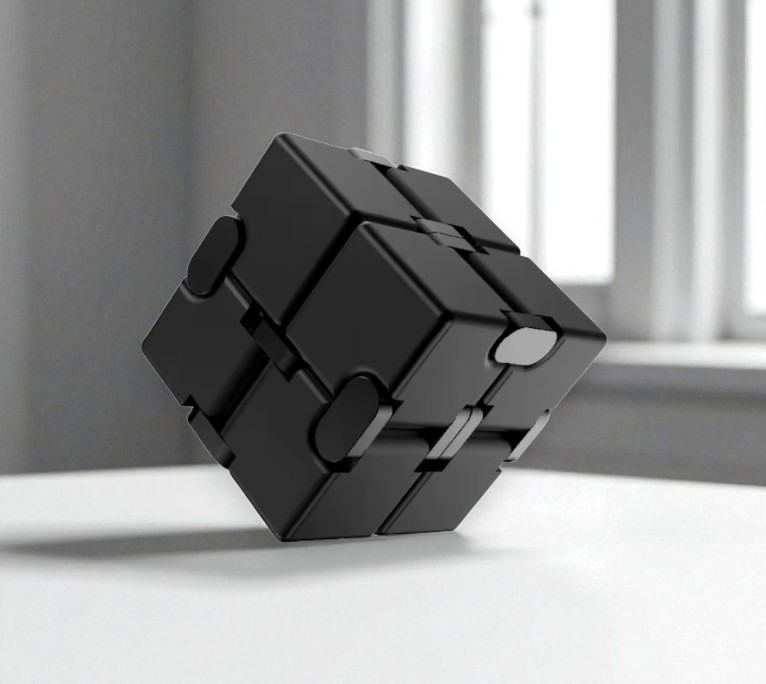
















Quelques fautes d’orthographes mais sinon très bon article (complet, agréable à lire, belles illustrations). Merci 🙂