– Qui es-tu ? Qui demande à entrer ici ?
– Je suis Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie.
– Je ne le connais pas ? Qui demande à entrer ici ?
– Je suis l’Empereur François-Joseph, roi apostolique de Hongrie, roi de Bohême, roi de Jérusalem, grand prince de Transylvanie, grand-duc de Toscane et de Cracovie, duc de Lorraine, de Salzbourg…
– Je ne le connais pas. Qui demande à entrer ici ?
– Je suis François-Joseph, un pauvre pécheur et j’implore la miséricorde de Dieu.
– Alors, tu peux entrer.
Ce dialogue rituel est répété à la mort de chaque souverain d’Autriche. Celui-ci est prononcé à Vienne le 30 novembre 1916, en pleine guerre, par le grand-maître de cour de la Hofburg et le père abbé de l’Eglise des Capucins. C’est le jour des funérailles de l’empereur François-Joseph (règne de 1848 à 1916), avant-dernier monarque régnant de la dynastie des Habsbourg.
Son héritier, Charles Ier (r. 1916-1918), pris dans les tourments de la Première Guerre mondiale, ne règne même pas deux ans. Il meurt en exil 4 ans plus tard à Madère, dans le dénuement total, laissant seule sa femme Zita, enceinte de leur huitième enfant.
Triste fin pour une dynastie dont le territoires s’étendait du Pérou à la Hongrie aux heures de sa plus grande gloire. Pourtant, l’histoire des Habsbourg est indissociable de l’histoire de l’Europe. Qui ne connaît pas aujourd’hui l’impératrice Sissi ? D’autres noms portent la gloire des Habsbourg : Charles Quint, Philippe II et François-Joseph, bien sûr.
Rien ne prédisposait pour autant cette modeste maison à devenir l’une des plus puissantes dynasties d’Europe.
Les origines de la dynastie des Habsbourg entre Suisse et Alsace

La maison d’Autriche est originaire du sud de l’Allemagne médiévale, entre la Suisse alémanique, le Bade-Wurtemberg et l’Alsace. Les Habsbourg tirent d’ailleurs leur nom d’un château situé en Suisse.
Des célèbres ancêtres de la dynastie, on connait surtout Gontran le Riche, un noble d’origine alsacienne du Xème siècle ap. J.-C. Cette généalogie apparaissait à l’époque bien peu prestigieuse, en comparaison avec celle d’autres puissantes familles allemandes comme les Staufer ou les Wittelsbach…
Une fois devenus empereurs, les Habsbourg tentèrent de se doter d’ancêtres mythiques et glorieux. Ils prétendirent ainsi descendre de la gens iulia de la Rome antique, et donc de Jules César. Ils affirmèrent aussi descendre des Anicii, la famille du pape Saint Grégoire le Grand (590-604), ou encore la dynastie mérovingienne.
Bien sûr, rien ne permet de confirmer l’authenticité de ces prétentions. Plutôt que de l’Histoire, elles relèvent plutôt d’habiles opérations de propagande et de légitimation de leurs prétentions futures à gouverner le monde !
L’ascension de la famille
Dès le XIème siècle, les comtes de Habsbourg ont l’intelligence de lier leur sort à celui d’une des plus grandes familles allemandes : celle des ducs de Souabe, les Hohenstaufen.
Preuve de leur engagement, les Habsbourg prêtent main forte aux Hohenstaufen dans leurs nombreuses campagnes militaires en Allemagne, ou en Italie.
Ils récupèrent en héritage nombre de territoires dont les dynasties avaient été anéanties par la politique des empereurs Hohenstaufen. Petit à petit, les Habsbourg s’imposent comme des acteurs importants sur la scène politique du Saint-Empire.
Le Saint-Empire romain germanique

Fondé par Otton Ier le Grand en 962, le Saint-Empire romain germanique n’est ainsi dénommé qu’au XVème siècle.
C’est au départ un Empire qui prétend prendre la succession de l’Empire romain. Le titre des dirigeants de ses dirigeants a varié au cours des siècle. Par souci de clarté, on nomme en français son dirigeant empereur romain germanique ou empereur des Romains.
Jusqu’à sa mort, en 1806, le Saint-Empire ne parvint jamais à constituer un État-nation comme la France ou le Royaume-Uni. C’était plutôt un agrégat d’États qui jouissaient chacun de leur indépendance. À partir du 15ème, les Habsbourg accaparent la dignité impériale et en fond un instrument de leur prestige et de leur influence.
Le règne fondateur de Rodolphe de Habsbourg

L’histoire de la dynastie connaît un tournant spectaculaire au XIIIème siècle sous le règne de Rodolphe de Habsbourg (r. 1273 – 1291).
C’est le premier membre de la famille à devenir empereur des Romains en 1273.
Les princes électeurs pensent avoir élu un souverain terne et sans envergure. S’il est alors l’un des plus puissants seigneurs d’Allemagne du sud, Rodolphe Ier fait manifestement pâle figure devant ses prédécesseurs Hohenstaufen, Frédéric Barberousse, Henri VI ou Frédéric II…

Rodolphe Ier déçoit rapidement ces espoirs et montre sa valeur. Il devient en effet le premier Habsbourg à porter le titre de duc d’Autriche. L’extinction de la famille régnante des Babenberg avait entraîné une période d’instabilité dans ce pays, au cours de laquelle de nombreux princes s’étaient disputés le prestigieux duché.
En 1278, Rodolphe s’impose définitivement en Autriche. La même année, à la bataille de Marchfeld, il vainc le roi de Bohême Ottokar II avec l’aide du roi de Hongrie. Ce succès déplace à l’est le centre de gravité de sa dynastie. Il jette ainsi les bases de la puissance future des Habsbourg dans les régions danubiennes.
Rodolphe meurt néanmoins avant d’avoir pu être couronné Empereur par le Pape.
Les Habsbourg à la conquête de l’Europe
Accès de Frédéric III à l’Empire

Il faut attendre 1440 pour qu’un Habsbourg devienne de nouveau empereur. Frédéric III (r. 1457 – 1493), qui est le premier d’entre eux à monter officiellement sur le trône.
Les Habsbourg monopoliseront la dignité impériale à partir de ce règne – à l’exception d’un bref intermède au milieu du XVIIIème siècle – jusqu’à son abolition en 1806.
Frédéric III lui-même n’impressionne pas. C’est un médiocre chef de guerre. Il est ainsi incapable de mater la rébellion hussite en Bohême. Ses propres territoires sont même envahis par le puissant roi de Hongrie, Matthias Corvin, au cours des années 1480.
Il parvient malgré tout à étendre ses domaines en Allemagne du sud grâce à des héritages territoriaux. La famille acquiert le Tyrol, une région riche et stratégique. Sa politique matrimoniale est également un succès : il réussit à marier son fils Maximilien à l’une des femmes les plus courtisées de son temps, Marie de Bourgogne, héritière de l’une des plus puissantes familles d’Europe.
Maximilien et la puissance matrimoniale

Maximilien Ier (1493 – 1519), empereur de 1493 à 1519, parachève l’oeuvre de Frédéric III.
Dès 1477, il récupère le monumental héritage bourguignon de sa femme : la Franche-Comté, la Belgique actuelle ainsi qu’une large partie des Pays-Bas. La Bourgogne est cependant annexée par la France. À 18 ans, Maximilien se retrouve à la tête d’immenses territoires, riches et bien situés.
En 1490, les Hongrois se retirent de l’Autriche. Après avoir réaffirmé le pouvoir des Habsbourg sur ces terres, Maximilien lance une ambitieuse politique diplomatique dont le but est de contrecarrer l’action des rois de France, en Italie notamment.
Les opérations militaires n’ont que de modestes résultats, mais Maximilien parvient à défendre son empire. Surtout, il a l’immense intelligence de se lier avec les souverains d’Espagne, Isabelle de Castille et Ferdinand d’Aragon : en 1496, il marrie son fils Philippe le Beau avec leur fille Jeanne. En même temps, la maison d’Autriche conserve des liens familiaux avec les souverains de Bohême et de Hongrie. Cette alliance se révélera capitale par la suite.

Par une politique prudente et patiente, les Habsbourg ont petit à petit constitué un territoire étendu qui, à la fin du XVe siècle, leur permet de figurer au premier rang des souverains européens tout en renforçant leur emprise sur le Saint-Empire.
Contrairement à une légende tenace, ils ont souvent dû guerroyer pour ce faire. Mais il reste que leurs succès doivent également beaucoup à une diplomatie et une politique matrimoniale très bien menées. C’est de cette époque que date le proverbe, attribué à Matthias Corvin, pour railler son voisin peu belliqueux :
« Bella gerant alii, tu felix Austria nube »
« Les autres font la guerre, toi, heureuse Autriche, tu te maries ».
Les Habsbourg à la conquête du monde

Maximilien n’aura pas le temps de récolter les fruits de sa sage politique. Son fils, Philippe le Beau (1478 – 1506), mort avant son père, non plus. C’est au fils de ce dernier, l’empereur Charles Quint (1519 – 1558), qu’il appartient finalement de régner sur le plus grand empire européen depuis Charlemagne.
L’héritage de Charles Quint

Charles Quint hérite des Pays-Bas bourguignons (1506), de l’Espagne et de ses territoires italiens (1516), de l’Autriche (1519) et devient empereur du Saint-Empire (1520). Mais son pouvoir ne s’arrête pas là.
Son prodigieux empire s’agrandit encore au cours du siècle grâce à l’expansion coloniale de la Castille en Amérique. S’appuyant sur ces nombreux territoires, Charles Quint mène toute sa vie des guerres incessantes contre ses rivaux français, François Ier et Henri II et contre l’Empire ottoman qui occupe alors tout le quart sud-est de l’Europe.
Les ennemis de Charles Quint
Le protestantisme

En 1517, Martin Luther publie ses 95 thèses. Un nouvel adversaire des Habsbourg apparaît : le protestantisme. Celui-ci se diffuse rapidement dans le Saint-Empire puis sur le reste du continent.
Cette nouvelle confession menace l’unité de l’Empire des Habsbourg, d’autant qu’elle sert d’instrument à la volonté d’indépendance de certains princes allemands. À la fin des années 1540, le conflit s’envenime, forçant Charles Quint à intervenir militairement en Allemagne afin d’y supprimer une insurrection protestante.
Désormais, la maison d’Autriche s’identifiera de plus en plus à la défense de la religion catholique en Europe.
Les Ottomans

En parallèle, l’expansion ottomane en Europe centrale bénéficie de manière indirecte aux Habsbourg : en effet, à la bataille de Mohacs en 1526, le roi Louis II de Hongrie est tué par Soliman le Magnifique, sans laisser d’héritier.
Le frère de Charles, Ferdinand Ier (1503 – 1564), revendique les couronnes de Hongrie et de Bohême et parvient à l’emporter face à ses rivaux en 1529.
Certes, du fait de l’avancée ottomane, la majeure partie de la Hongrie lui échappe et ne sera pas conquise avant la fin du XVIIème siècle. L’armée turque, redoutable machine de guerre, assiège même Vienne en 1529 et la menace à nouveau en 1532 !
Toutefois, en régnant sur la Bohême, la Hongrie royale, l’Autriche et le Tyrol, Ferdinand pose les bases d’un Empire Habsbourg au centre de l’Europe, un fait majeur dans l’histoire du continent européen.
Charles Quint abdique, les Habsbourg se divisent

En 1556 et 1558, Charles Quint, usé par la goutte et des conflits qui n’en finissent pas, abdique de tous les trônes qu’il occupait alors.
Ferdinand Ier (1520 – 1564), son frère, conserve les territoires autrichiens, la Bohême, la Silésie et la Hongrie royale. Il devient également empereur romain germanique.
Le fils de Charles, Philippe II d’Espagne (1527 – 1598) récupère tous les autres domaines des Habsbourg : l’Espagne et ses colonies, mais aussi l’Italie du sud, Milan, la Franche-Comté et les Pays-Bas.
Désormais, les intérêts des deux branches de la maison d’Autriche divergent. Le branche allemande est notamment plus conciliante avec le protestantisme. Les Habsbourg d’Espagne sont en outre bien plus puissants que leurs cousins d’Europe centrale.
Philippe II : souverain le plus puissant d’Europe

Du début de son règne en 1556 à sa mort en 1598, Philippe II est le souverain le plus puissant d’Europe.
Il profite notamment des guerres de religion en France, aux Pays-Bas et en Angleterre pour se poser en champion du catholicisme sur le continent, au moment où les Habsbourg d’Autriche se montrent plutôt tièdes en matière de religion.
Ses armées parviennent à reprendre le sud des Pays-Bas (mais pas le nord), occupent le Portugal en 1580 – Philippe ayant hérité du trône suite à la mort du roi portugais – et interviennent en France à plusieurs reprises pour empêcher un succès protestant.
Sa marine contribue puissamment à la défaite de l’Empire ottoman à Lépante en 1571 mais elle est défaite au large de l’Angleterre en 1588 (épisode de la l’Invincible Armada). Enfin, l’empire colonial espagnol continue de s’étendre en Amérique ainsi qu’en Asie avec la colonisation des Philippines.

Si la fin de la vie de Philippe II est marquée par des revers en France ou en Angleterre, ils ne remettent guère en cause la puissance hégémonique de l’Espagne, crainte par l’ensemble des autres pays européens.
Au même moment, les Habsbourg d’Allemagne ont du mal à défendre leurs territoires face aux Ottomans. Leurs offensives pour reconquérir la Hongrie échouent. Leur pouvoir réel sur les États du Saint-Empire reste largement théorique : de nombreux princes allemands sont indépendants dans les faits.
Ferdinand et son fils, Maximilien II (1564 – 1576), font preuve de prudence. Ils ménagent volontiers les protestants et évitent soigneusement toute guerre de religion dans l’espace impérial. Cette politique prendra cependant fin au début du XVIIème siècle, à l’heure où l’Église lance la contre-réforme catholique en Europe centrale.
Décadence en Espagne, succès en Europe centrale
Au XVIIème siècle, la roue tourne pour les deux branches Habsbourg. Pour la branche espagnole, c’est la décadence, pour la branche autrichienne, c’est l’ascension.
La décadence des Habsbourg d’Espagne
La guerre de Trente Ans (1618-1648) voit les Habsbourg espagnols voler au secours de leurs cousins allemands. Ce terrible conflit signe l’échec de la maison d’Autriche à rétablir une autorité pleine et entière sur le Saint-Empire contre les princes protestants. Avec les traités de Westphalie (1648), les princes allemands acquièrent une pleine souveraineté sous protection de la France.
Pour les Habsbourg d’Espagne, c’est le chant du cygne. Ils sont affaiblis par leurs échecs face aux Français, par l’indépendance du Portugal et par des crises économiques à répétition qui secouent l’Espagne. Avec le traité des Pyrénées de 1659, Habsbourg et Capétiens mettent fin à leur conflit, mais c’est la France qui devient la puissance prépondérante sur le continent.

La deuxième partie du siècle confirme le déclin de la branche espagnole. Charles II (1665-1700), dit l’Ensorcelé, ne peut pas diriger le royaume. Fruit des nombreux mariages consanguins des Habsbourg, il est faible, chétif, attardé et stérile. Une catastrophe.
En quelques décennies, la glorieuse monarchie espagnole devient un Etat de second rang. Elle est incapable de s’opposer aux visées hégémoniques de Louis XIV. Le jeune roi s’impose alors avec fracas sur le théâtre européen avec la guerre de Dévolution de 1667-1668.
Plus grave encore : Charles II, stérile, n’a pas d’héritier. Louis XIV veut placer sa famille à la tête de son voisin ibérique. Après la guerre de succession d’Espagne (1701-1714), la maison d’Autriche perd définitivement le pays, qui passe aux mains de la dynastie des Bourbons avec l’accession au trône de Philippe V.
L’ascension des Habsbourg d’Autriche

Alors que la branche espagnole finit par disparaître, la branche allemande des Habsbourg monte en puissance.
Après l’échec de la guerre de Trente ans, Ferdinand III puis son successeur, Léopold Ier (1640 – 1705), mobilisent les princes du Saint-Empire pour lutter contre l’hégémonie française. Fort de ce soutien, l’Autriche participe activement aux guerres de Hollande (1672-1678), de la Ligue d’Augsbourg (1688-1697) et de Succession d’Espagne, sous la direction du prince Eugène de Savoie.
Surtout, les Autrichiens parviennent à mettre fin à l’expansion des Ottomans en Europe. En 1683, le siège de Vienne par les Turcs échoue.
S’ils ne parviennent pas à conserver l’Espagne dans leur giron, les Habsbourg gagnent néanmoins de nombreux territoires en Italie ainsi que les anciens Pays-Bas espagnols.
À l’est, les victoires contre les Ottomans leur permettent d’agrandir considérablement leur territoire. De 1664 à 1718, ils intègrent ainsi la Hongrie centrale, la Transylvanie et le nord de la Serbie (qui sera ensuite majoritairement reprise par les Turcs).
La création d’un État Habsbourg

Le nouvel ensemble de territoires constitués par les Habsbourg en Europe centrale présente toutefois des fragilités.
Elles se révèlent sous le règne de Charles VI (1711-1740), mécène exceptionnel, mais piètre politique. Des défaites à répétition lui font perdre Belgrade face aux Ottomans et le sud de l’Italie, récupéré par les Bourbons d’Espagne. Il se montre surtout incapable de réformer les institutions très hétérogènes de ses territoires d’Europe centrale et d’y d’établir une administration moderne.
Celle qui lui succède, Marie-Thérèse d’Autriche (1740 – 1780), paiera cher cet affaiblissement.
La perte de la Silésie

En 1740, coup de tonnerre ! Le jeune Frédéric II (1712 – 1786) de Prusse fait valoir ses ambitions. La Prusse envahit par surprise la Silésie, au nord de l’Empire. La nouvelle souveraine, Marie-Thérèse d’Autriche, n’a guère de forces à lui opposer sauf des armées dangereusement affaiblies. La France s’en mêle. Elle intervient en Allemagne avant de pousser jusqu’en Bohême, tandis que la Bavière revendique la dignité impériale.
Après plusieurs années difficiles pour les Habsbourg, la Guerre de Succession d’Autriche prend fin en 1748. Marie-Thérèse a perdu la Silésie, mais elle a réussi à défendre le reste de ses territoires tout en mettant fin aux prétentions bavaroises sur l’Empire.
Les réformes de Kaunitz

Marie-Thérèse est consciente des faiblesses de sa monarchie. Elle lance avec l’aide décisive du chancelier Wenzel von Kaunitz (1711 – 1794) une ambitieuse politique de réformes pour renforcer son armée, rationaliser l’organisation de ses ministères et établir une administration plus solide dans ses territoires.
Cette politique cimente les territoires hétérogènes des Habsbourg dans un ensemble qui servira de socle à un empire unifié au XIXème siècle. Peu à peu, ces territoires deviennent une entité autonome, séparé d’un Saint–Empire désormais vidé de sa substance.
Ces réformes consolident la position de l’Autriche : au cours de la guerre de Sept Ans (1756-1763), Marie-Thérèse fait bonne figure face à la Prusse, sans parvenir cependant à reprendre la Silésie.
L’empereur Joseph, despote éclairé

Le fils de Marie-Thérèse, Joseph II (1780 – 1790), devient empereur dès 1765. Il lui faut néanmoins attendre la mort de sa mère en 1780 pour pouvoir pleinement appliquer son propre programme de réforme.
Très influencé par les Lumières, il met en œuvre une politique de modernisation radicale, fondé sur une centralisation administrative, une plus grande tolérance religieuse et la lutte contre l’influence de l’Eglise catholique dans la vie sociale et économique du pays.
En 1784, Joseph II fait de l’allemand la langue administrative de son empire multinational. Parmi ses nombreuses réformes, il réduit le nombre de séminaires et supprime des congrégations religieuses. Il instaure le mariage civil, supprime les jurandes, abolit le servage. Réforme audacieuse pour l’époque, il instaure un impôt par tête payable par tous les propriétaires, sans exception.
Toutefois, ses réformes mécontentent la noblesse et de nombreux sujets attachés à leurs traditions. En 1789, les Pays-Bas autrichiens (la Belgique actuelle) entrent en révolte contre leur souverain. L’agitation gagne la Hongrie. Lorsqu’il meurt en 1790, Joseph II a ainsi dû abroger la plupart des mesures qu’il avait prises au cours de la décennie précédente.
Le temps des Habsbourg conservateurs

Léopold II (1790 – 1792) fait le bilan de la parenthèse joséphiste. Pragmatique, le nouveau monarque comprend la difficulté à appliquer des réformes radicales dans un ensemble aussi hétérogène que l’Empire d’Autriche. Il choisit la voie d’un conservatisme mesuré malgré ses propres sympathies pour les Lumières.
Son fils, François Ier d’Autriche (1792 – 1835) se montre nettement plus hostile aux évolutions politiques de son époque.
Lorsque la France révolutionnaire déclare la guerre à l’Autriche en 1792, les Habsbourg font face à un ennemi mortel. Ils deviennent les champions de l’absolutisme et s’opposent avec acharnement aux idées nouvelles.
De 1792 à 1815, l’Autriche est presque constamment en guerre avec la France, au péril de sa propre existence. Elle manque de peu le dépècement aux traités de Presbourg (1805) et Schönbrunn (1809). Pourtant, sous l’impulsion du chancelier Klemens von Metternich (1773 – 1859), elle participe activement aux campagnes de 1813-1815 qui provoquent la chute de l’Empereur français.
L’Europe du congrès de Vienne

En reconnaissance de ce rôle, c’est Vienne qui accueille, à partir de 1814, le grand congrès chargé de poser les bases du nouvel ordre européen suite à la fin du régime napoléonien : le Congrès de Vienne.
De 1815 à 1848, l’Empereur François et Metternich imposent un ordre très conservateur aussi bien à l’intérieur des frontières de leur Empire que sur le continent européen. L’armée autrichienne intervient plusieurs fois en Italie pour y écraser des révoltes libérales ou populaires. Dans les territoires autrichiens, la censure fait rage afin d’éviter toute agitation due aux idées politiques nouvelles. En effet, le développement du libéralisme politique et des nationalismes menacent l’antique monarchie autrichienne et son État plurinational.
Malgré son conservatisme, François ne restaure pas le Saint-Empire supprimé par Napoléon en 1806. Il préfère régner en tant qu’Empereur d’Autriche. François reste toutefois le maître des affaires allemandes, en tant que président de la Confédération germanique. Il doit toutefois composer avec un Royaume de Prusse sorti renforcé des guerres napoléoniennes.
Le dernier monarque de la vieille école : l’empereur François-Joseph

L’ordre conservateur imposé par le pouvoir impérial se fissure avec le printemps des peuples de 1848. Des manifestations ont ainsi lieu à Vienne et à Prague. En Italie, en Pologne ce sont des révoltes. En Hongrie, c’est une révolution contre le pouvoir Habsbourg !
L’armée autrichienne doit intervenir pour restaurer l’autorité du souverain. Il faut attendre 1849 et l’aide d’un corps expéditionnaire russe pour faire cesser tous les troubles en Hongrie.
C’est dans ce contexte difficile que l’empereur François-Joseph Ier (1830 – 1916) accède au pouvoir en 1848. Dans les années 1850, une fois les révoltes populaires matées, le nouveau souverain mène une politique « néo-absolutiste » et centralisatrice, faisant de son Empire un Etat unitaire administré par une puissante bureaucratie.
Cette période autoritaire est également marquée par une vraie prospérité économique mais elle s’achève par une succession de défaites contre la France (1859) et la Prusse (1866) qui font perdre à l’Autriche ses territoires italiens et son influence prépondérante en Allemagne.
De l’Empire d’Autriche à l’Autriche-Hongrie

Suite à ces graves revers, l’Empire autrichien se retrouve réduit à ses territoires d’Europe centrale. Surtout, François-Joseph est désormais convaincu de la nécessité de mettre fin à sa politique absolutiste et d’obtenir un compromis avec la Hongrie, toujours en proie à l’agitation nationaliste.
C’est chose faite en 1867 avec un accord qui prévoit l’instauration d’une double monarchie austro-hongroise ainsi qu’une large autonomie accordée au Royaume de Hongrie. L’Empire d’Autriche devient l’Autriche-Hongrie.
En revanche, les institutions impériales continuent à prendre en charge les affaires communes : la diplomatie, la guerre ou encore l’administration de la Bosnie-Herzégovine à partir de son invasion en 1878. Le parlementarisme est instauré dans les deux parties de l’Etat des Habsbourg, sans que les prérogatives de l’Empereur en soient fondamentalement remises en cause.

S’il stabilise la monarchie danubienne pour un temps, ce compromis déçoit toutefois les autres peuples de l’Empire qui espéraient une fédéralisation de celui-ci. Il sème ainsi les germes de conflits futurs, d’autant que l’élite hongroise se lance dans une politique controversée de « magyarisation » de leurs minorités ethniques.
Le développement économique
Le long règne de François-Joseph ( presque 68 ans ! ) est celui de la fin des illusions impériales.
Expulsée d’Italie, marginalisée en Allemagne après l’unification du pays par la Prusse (1871), l’Autriche-Hongrie ne peut plus s’étendre que dans les Balkans. Elle apparaît surclassée par le formidable développement industriel de l’Empire allemand, ainsi qu’un Empire russe bien plus peuplé qu’elle. De manière significative, l’Autriche n’a guère d’ambition coloniale et sa marine reste relativement faible.
François-Joseph est un homme attaché aux traditions et peu intéressé par les innovations du siècle. La Cour des Habsbourg est toujours marquée par une solennité et une pompe d’un autre âge, malgré les extravagances de l’impératrice Sissi.
Pour autant, le bilan du « dernier monarque de la vieille école » est loin de se résumer à un déclassement, ou à une décadence.
L’Autriche-Hongrie connaît un développement économique important. Elle s’industrialise rapidement, surtout à l’Ouest, grâce à une forte intégration commerciale des différents territoires. La société civile de l’Empire se révèle dynamique, particulièrement dans ses territoires occidentaux.
L’âge d’or de Vienne

Vienne connaît un véritable âge d’or économique et culturel vers la fin du règne de François-Joseph. Ville cosmopolite de plus de 2 millions d’habitants, elle est au cœur de mouvements artistiques célèbres tels le Jugendstil (art nouveau) ou la Sécession viennoise, portée par des artistes de renom tels que Gustav Klimt ou Egon Schiele.
La scène littéraire de la capitale autrichienne se développe également sous l’impulsion de grands auteurs comme Karl Kraus ou Arthur Schnitzler. Si la prépondérance viennoise en Europe centrale est incontestable, d’autres villes connaissent aussi un essor important à cette époque, comme Prague ou Budapest.
La chute des Habsbourg
Cette atmosphère brillante disparaît brutalement avec la Grande Guerre.
Une armée faible

C’est l’assassinat de l’héritier au trône d’Autriche, l’archiduc François-Ferdinand (1863 – 1914), et de sa femme, le 28 juin 1914, par un nationaliste serbe, par Gavrilo Princip, qui cause l’enchaînement fatal qui va entraîner l’Europe toute entière dans une guerre sanglante par un complexe jeu d’alliances : l’Autriche-Hongrie, alliée de l’Allemagne, finit par déclarer la guerre à la Serbie, appuyée par la Russie, elle-même alliée à la France…
La Grande Guerre sera fatale à l’empire pluriséculaire des Habsbourg. L’armée austro-hongroise est plus courageuse et motivée qu’on a pu le dire. Mais, mal équipée, mal commandée, elle devient rapidement dépendante de son homologue allemande.
Les forces austro-hongroises peuvent pourtant se prévaloir de quelques beaux succès, souvent obtenus grâce à l’aide de l’armée allemande : la défense de l’Isonzo en Italie, l’offensive de Galicie de 1915, l’invasion de la Roumanie en 1916 (dirigée par le général allemand von Mackensen) et la bataille de Caporetto en 1917.
La décomposition

1918, c’est l’année terrible. L’Autriche-Hongrie glisse sur la pente fatale de la décomposition. L’Empire ploie sous les nationalismes ethniques, encouragés par les puissances ennemis. En octobre, les multiples minorités de l’Empire proclament leur indépendance. De nombreux soldats de l’armée impériale désertent pour aller défendre leurs patries respectives, menacées par une offensive franco-serbe dans les Balkans.
Les troupes italiennes, aidées par ses alliées, écrasent l’armée autrichienne à la bataille Vittorio Veneto. En mars 1919, Charles Ier (1887 – 1922), le “dernier des Habsbourg”, doit fuir son pays.
En 1920, le Traité de Trianon consacre la fin définitive de l’Autriche-Hongrie et du règne des Habsbourg en Europe centrale.
L’héritage de la monarchie danubienne
L’empire des Habsbourg a longtemps eu mauvaise presse.
Il a ainsi été accusé d’être une « prison des peuples » ayant entravé les aspirations nationales et démocratiques des différents peuples qui y habitaient.
Cette mauvaise réputation est aujourd’hui remise en cause. De nombreux historiens (François Fetjö, Jean-Paul Bled, etc.) estiment ainsi que la chute de la double monarchie a pénalisé le développement économique de l’Europe centrale en y créant de nouvelles frontières, et a favorisé l’expansion de l’Allemagne nazie puis celle de l’Union soviétique dans cette région.
En outre, ils relèvent un effort limité mais réel de démocratisation des institutions impériales, avec le développement du parlementarisme et d’élections locales sous le règne de François-Joseph. Les conséquences de cette démocratisation n’ont pas toutes été heureuses : en atteste l’élection à répétition de l’antisémite Karl Lueger comme maire de Vienne entre 1895 et 1909.
La mémoire de l’Empire des Habsbourg aujourd’hui

L’Europe centrale et les Balkans ont souffert des guerres du XXème siècle et de multiples nettoyages ethniques. Ces souffrances ont contribué à réhabiliter la mémoire de l’empire multinational des Habsbourg, en discréditant le nationalisme ethnique qui avait provoqué sa chute.
Si elle n’a guère de relai politique, il existe dans la région une nostalgie de l’ère impériale et de ses fastes. Elle renvoie à une époque où l’Europe centrale, largement unifiée, connaissait un rayonnement économique et culturel qui suscitait l’admiration de nombreux observateurs étrangers.
L’universitaire et écrivain italien Claudio Magris a, par ailleurs, noté une forte influence de la mémoire de l’empire Habsbourg sur l’idéal européen, lui-même fondé sur la volonté d’un dépassement des nationalismes.
Stefan Zweig, dans Le monde d’hier, dit toute sa douleur d’avoir perdu sa Vienne cosmopolite.
Quant à Joseph Roth, inconsolable de la perte de sa patrie, il écrivait en préface de son plus célèbre roman, La Marche de Radetzky (1932) :
Une volonté cruelle de l’Histoire a réduit en morceaux ma vieille patrie, la Monarchie austro-hongroise. Je l’ai aimée, cette patrie, qui me permettait d’être en même temps un patriote et un citoyen du monde, un Autrichien et un Allemand parmi tous les peuples autrichiens. J’ai aimé les vertus et les avantages de cette patrie, et j’aime encore aujourd’hui, alors qu’elle est défunte et perdue, ses erreurs et ses faiblesses. Elle en avait beaucoup. Elle les a expiées par sa mort.
Bibliographie
- Histoire de l’Autriche, Jean Bérenger
- Histoire de l’Empire des Habsbourg, Jean Bérenger (L’acheter)
- Histoire de l’Espagne, Joseph Pérez (L’acheter)
- Marie-Thérèse d’Autriche, Jean-Paul Bled (L’acheter)
- François-Joseph, Jean-Paul Bled (L’acheter)
- Danubio, Claudio Magris
- Requiem pour un empire défunt, François Fetjö
- Le monde d’hier, Stéphane Zweig






























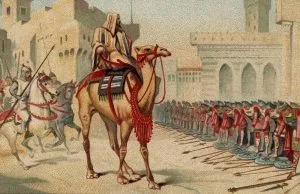





les HABSBOURG ne sont pas ce qu’on croit ….
Bonjour, après avoir lu tous vos articles ainsi que le livre de Jean des Cars “La saga des Habsbourg ” ainsi qu’un voyage à Vienne, je suis à la recherche de références de livres concernant la vie quotidienne à la cour. Aurriez vous des lectures à me conseiller? Merci pour votre page
Je remercie vivement Clément Chapon pour ce vaste, clair et nuancé panorama de l’histoire des Habsbourg qui se déroule sous nos yeux et s’imprime aussi dans la mémoire, chose plus rare!
C’est la lecture d’un roman-saga d’Ernst Lothar: “Mélodie de Vienne”, histoire d’une famille viennoise de facteurs de pianos , depuis la mort du prince héritier Rodolphe jusqu’à l’entrée d’Hitler, qui m’a poussée à une recherche sur cette
dynastie.Je ne pouvais mieux tomber.
Parfait.
magnifique document rien à redire