Un oxymore (synonyme : alliance de mots) est une figure de style par laquelle on allie deux termes qui semblent se contredire. On rapproche de manière paradoxale des termes qui peuvent paraître contraires. En d’autres termes, dans l’oxymore, un même objet a des qualités contradictoires. Cette alliance de mots contraires n’est pas une alliance incompatible, elle crée un sens. Les termes contradictoires d’un oxymore doivent toujours appartenir à la même entité de mots (au même syntagme, cela ne peut pas être deux phrases séparées l’une de l’autre).
Ce qu’il faut retenir
-
L’oxymore unit deux mots contradictoires : « silence éloquent ».
-
Il crée un impact immédiat en surprenant le lecteur.
-
L’oxymore révèle des nuances subtiles : « douce violence ».
-
Il oblige à réfléchir pour saisir le sens caché.
-
Différent de l’antithèse, il rapproche des termes contigus.
Caractéristiques essentielles de l’oxymore
L’oxymore possède plusieurs
caractéristiques fondamentales qui le distinguent des autres
figures de style. La proximité immédiate des
termes contradictoires constitue sa première spécificité.
Contrairement à d’autres procédés rhétoriques, l’oxymore exige une
contiguïté syntaxique : les mots opposés doivent
se toucher directement dans la phrase.
Cette figure de style fonctionne
selon un principe de tension créatrice. Loin de
s’annuler mutuellement, les termes contradictoires génèrent une
signification nouvelle. Cette signification émergente dépasse la simple somme des
parties. Vous découvrez alors un sens que ni l’un ni l’autre des
termes ne possédait isolément.
Deux exemples d’oxymore : obscure clarté, orgueilleuse faiblesse
Le dramaturge Corneille nous a donné le plus célèbre exemple d’oxymore :
- Cette obscure clarté qui tombe des étoiles Enfin avec le flux nous fait voir trente voiles ; (Le Cid, IV, 3)
Dans cet exemple, l’oxymore se trouve dans obscure clarté. De prime abord, on considère que la clarté, ce qui est clair, ne peut pas être obscur. La plupart du temps, l’oxymore associe un nom avec un adjectif. Mais l’oxymore peut s’appliquer à d’autres groupes de mots : nom et complément du nom, nom et adverbe, etc.
Autre exemple. Racine a créé un autre oxymore célèbre :
- Moi-même, je l’avoue avec quelque pudeur, Charmé de mon pouvoir et plein de ma grandeur, Ces noms de roi des rois et de chef de la Grèce Chatouillaient de mon coeur l’orgueilleuse faiblesse. (Racine, Iphigénie, I, 1)
L’oxymore se trouve bien sûr sur les termes orgueilleuse faiblesse.
Analyse technique des structures oxymoriques
Ces exemples illustrent
parfaitement la mécanique interne de l’oxymore.
Dans “obscure clarté”, vous observez comment l’adjectif “obscure”
module le substantif “clarté” sans l’annuler. L’effet produit
transcende la simple contradiction logique.
De même, “orgueilleuse faiblesse”
révèle une complexité psychologique que les termes
pris séparément ne sauraient exprimer. Cette faiblesse n’est pas
honteuse. Elle tire sa force de l’orgueil même qui la nourrit.
Racine dévoile ainsi les paradoxes intimes de
l’âme humaine.
À lire en cliquant ici : la liste de toutes les figures de style essentielles de la langue française.
À quoi servent les oxymores ?
Les oxymores sont des alliances
surprenantes de mots. Les auteurs veulent ainsi stupéfier
leurs lecteurs et les amener à reconsidérer leur
perception habituelle des choses. Ainsi, on parle souvent d’un silence
éloquent. Comment un silence peut-il être
éloquent, c’est-à-dire comment peut-il « bien
parler » ? On comprend pourtant tout de suite le sens de
cet oxymore : parfois, un silence en dit bien plus qu’un long
discours.
Reprenons notre exemple de «
l’obscure clarté » de Corneille. C’est une
réplique de Don Rodrigue, qui attend près de la mer, la nuit,
l’attaque des Maures. Utiliser cet oxymore ne semble-t-il pas plus
vrai, plus clair pour parler de la lumière produite par les étoiles
dans la nuit, plutôt qu’écrire à la place « la faible clarté
nocturne des étoiles qui nous laissait voir les voiles » ?
Dans l’obscure clarté, cette clarté,
malgré son obscurité, reste une clarté qui illumine la nuit.
La clarté domine en quelque sorte
l’obscurité.
Devant un oxymore, il faut se demander quel est le terme qui domine.
Notre deuxième exemple, tiré d’Iphigénie, associe paradoxalement la faiblesse et l’orgueil. Comment peut-on être orgueilleux de sa propre faiblesse ? On attendrait plutôt honteuse faiblesse. Le contexte l’explique : Agamemnon, qui est le personnage qui dit cet oxymore, malgré un premier mouvement de répugnance, est finalement prêt à sacrifier sa propre fille Iphigénie pour vaincre les Troyens, par amour de son propre pouvoir et par amour de lui-même. Son orgueil est sa faiblesse, qui lui fait aimer le pouvoir, parce qu’il s’aime trop lui-même. L‘orgueilleuse faiblesse d’Agamemnon rend en définitive le personnage peu sympathique.
Les fonctions expressives de l’oxymore
L’oxymore remplit plusieurs
fonctions expressives essentielles. Il permet d’abord une
condensation sémantique remarquable. En deux mots,
vous exprimez une idée complexe qui nécessiterait normalement
plusieurs phrases d’explication.
Cette figure de style génère
également un effet de saisissement. Elle oblige
votre esprit à s’arrêter, à réfléchir. Pourquoi ces mots
contradictoires sont-ils assemblés ? Quel sens nouveau émerge de
cette alliance ? Cette pause cognitive favorise une
mémorisation durable du message.
L’oxymore révèle enfin des nuances psychologiques subtiles. Il excelle à traduire les états d’âme ambivalents, les sentiments mélangés, les situations paradoxales. Il devient alors l’outil privilégié pour exprimer la complexité humaine.
Oxymore et antithèse
En quoi l’antithèse se distingue-t-elle de l’oxymore ? Une antithèse ne consiste pas à accoler deux termes contraires l’un à l’autre. Elle consiste plutôt à allier deux propositions ou deux groupes de mots contraires l’un de l’autre. On essaie ainsi de faire ressortir un contraste. Montesquieu nous donne ici un bon exemple par cette antithèse : « Non, j’ai pu vivre dans la servitude, mais j’ai toujours été libre. » (Montesquieu, Lettres Persanes)
Montesquieu fait ici contraster le fait que, même si son personnage a vécu dans un régime politique où la servitude règne, il a toujours été intérieurement libre. S’il avait usé d’un oxymore, il aurait pu écrire : « J’ai vécu dans une libre servitude. ». L’oxymore change le sens de la phrase de Montesquieu. La « libre servitude » est une notion plus ambiguë, elle peut aussi vouloir dire que l’on consent à sa servitude ou que l’on se sent libéré par sa servitude.
Tableau comparatif des figures de style
| Figure de style | Structure | Effet produit | Exemple |
|---|---|---|---|
| Oxymore | Mots contradictoires accolés | Sens nouveau par fusion | Douce violence |
| Antithèse | Propositions opposées | Contraste par opposition | Riche par l’argent, pauvre par l’âme |
| Paradoxe | Idée apparemment contradictoire | Réflexion sur la logique | Plus on sait, moins on sait |
Étymologie d’oxymore
Oxymore vient du grec oxumôron, ὀξύμωρος, « fin sous une apparence de niaiserie », « ingénieuse alliance de mots contradictoires », composé d’oxy (aigu, spirituel, effilé) et de môros (épais, sot, mou). Le terme oxymore est donc lui-même un oxymore.
Évolution historique du terme
Cette étymologie révèle la subtilité
conceptuelle des anciens Grecs. Ils avaient saisi que
certaines expressions dépassent la logique ordinaire pour atteindre
une vérité supérieure. L’oxymore grec désignait déjà cette
intelligence paradoxale qui émerge de la
contradiction apparente.
Le terme a traversé les siècles en
conservant sa puissance évocatrice. Du grec ancien
au français moderne, il a gardé sa capacité à désigner ces
alliances de mots qui révèlent plus qu’elles ne cachent. Cette
permanence témoigne de l’universalité du procédé dans l’expression
humaine.
Exemples d’oxymores
- Un silence assourdissant.
- Un mort-vivant.
- Festina lente (« Hâte-toi lentement ! »).
- (Argan) Par ma foi, voilà un beau jeune vieillard pour quatre-vingt-dix ans ! (Molière, Le Malade imaginaire, III, 10)
- Le nom du conte de Voltaire Micromegas associe micro (petit en grec) et megas (grand en grec).
- Dans l’exemple suivant, Voltaire utilise bien sûr l’oxymore boucherie héroïque pour tourner en dérision le meilleur des mondes où la guerre fauche nombre de vies : La baïonnette fut aussi la raison suffisante de la mort de quelques milliers d’hommes. Le tout pouvait bien se monter à une trentaine de mille âmes. Candide, qui tremblait comme un philosophe, se cacha du mieux qu’il put pendant cette boucherie héroïque. (Voltaire, Candide)
- Hugo a écrit ce sublime oxymore à propos de la mort de Gavroche : « Cette petite grande âme venait de s’envoler. » (Victor Hugo, Les Misérables)
- Hugo se moque ici de l’être humain qui se glorifie d’une histoire faite de guerres et de meurtres : Je sais que c’est la coutume D’adorer ces nains géants Qui, parce qu’ils sont écume, Se supposent océans ; (Victor Hugo, Les Contemplations, XVIII)
- L’oxymore « Soleil noir », employé ici par Nerval, est un lieu commun du langage poétique :
Je suis le Ténébreux, – le Veuf, – l’Inconsolé, Le Prince d’Aquitaine à la Tour abolie : Ma seule Etoile est morte, – et mon luth constellé Porte le Soleil noir de la Mélancolie. (Nerval, El Desdichado)
- Le simple oxymore sublime horreur ramasse le portrait fait par Balzac du colonel Chabert, entre horreur et sublimation :
Les bords du chapeau qui couvrait le front du vieillard projetaient un sillon noir sur le haut du visage. Cet effet bizarre, quoique naturel, faisait ressortir, par la brusquerie du contraste, les rides blanches, les sinuosités froides, le sentiment décoloré de cette physionomie cadavéreuse. Enfin l’absence de tout mouvement dans le corps, de toute chaleur dans le regard, s’accordait avec une certaine expression de démence triste, avec les dégradants symptômes par lesquels se caractérise l’idiotisme, pour faire de cette figure je ne sais quoi de funeste qu’aucune parole humaine ne pourrait exprimer. Mais un observateur, et surtout un avoué, aurait trouvé de plus en cet homme foudroyé les signes d’une douleur profonde, les indices d’une misère qui avait dégradé ce visage, comme les gouttes d’eau tombées du ciel sur un beau marbre l’ont à la longue défiguré. Un médecin, un auteur, un magistrat eussent pressenti tout un drame à l’aspect de cette sublime horreur dont le moindre mérite était de ressembler à ces fantaisies que les peintres s’amusent à dessiner au bas de leurs pierres lithographiques en causant avec leurs amis.
Balzac, Le Colonel Chabert
- Rimbaud utilise aussi de nombreuses fois l’oxymore pour mieux appuyer le récit de ses illuminations :
Élan insensé et infini aux splendeurs invisibles, aux délices insensibles, – et ses secrets affolants pour chaque vice – et sa gaîté effrayante pour la foule – (Rimbaud, Illuminations, Solde)
- On retrouve aussi de nombreux oxymores chez Baudelaire :
Mon enfant, ma soeur, Songe à la douceur D’aller là-bas vivre ensemble ! Aimer à loisir, Aimer et mourir Au pays qui te ressemble ! Les soleils mouillés De ces ciels brouillés Pour mon esprit ont les charmes Si mystérieux De tes traîtres yeux, Brillant à travers leurs larmes.
L’invitation au voyage
Tout l’hiver va rentrer dans mon être : colère, Haine, frissons, horreur, labeur dur et forcé, Et, comme le soleil dans son enfer polaire, Mon coeur ne sera plus qu’un bloc rouge et glacé.
Chant d’automne
Oxymores dans la langue contemporaine
L’oxymore ne se limite pas à la
littérature classique. Il irrigue notre langue
quotidienne avec une vitalité surprenante. Vous employez
régulièrement des oxymores sans vous en apercevoir. Cette
banalisation témoigne de leur efficacité
expressive.
Observez ces expressions courantes :
“un géant minuscule”, “une sage folie”, “un froid brûlant”, “un
silence parlant”. Chacune révèle une nuance
sémantique impossible à rendre autrement. L’oxymore
devient alors un outil de précision linguistique
remarquable.
Exemples d’oxymores en politique

Ce célèbre slogan de campagne permet
de rassurer l’électorat : la force d’un programme
ambitieux (le socialisme, l’appropriation collective des moyens de
productions, qui supposait des réformes importantes voire…une
révolution économique) tout en s’enracinant dans les traditions du
pays (la notion communiquée par
tranquille), loin de tout renversement.
C’est en quelque sorte un changement dans la
continuité. Parfois, le vocabulaire politique utilise
l’oxymore pour faire passer une message
idéologique (bon ou mauvais) : le commerce équitable, une
guerre propre, la discrimination positive, etc.
L’oxymore dans la publicité et le marketing
Les publicitaires exploitent
habilement la puissance évocatrice de l’oxymore.
Cette figure de style permet de créer des slogans mémorables qui
marquent les esprits. Vous retenez facilement ces formules
paradoxales qui interpellent votre logique habituelle.
Des expressions comme “luxe
abordable”, “simplicité sophistiquée” ou “tradition innovante”
parsèment les discours commerciaux. Elles
promettent l’impossible : concilier des qualités normalement
exclusives. Cette promesse, même illusoire, séduit le consommateur
en quête d’exceptions.
L’oxymore publicitaire fonctionne comme un miroir aux alouettes linguistique. Il fait briller ce qui devrait ternir.
Comment reconnaître un oxymore efficace
Tous les oxymores ne se valent
pas. Certains révèlent des vérités profondes,
d’autres restent des artifices vides. Pour distinguer un oxymore
réussi, vous devez analyser sa capacité
révélatrice. Un bon oxymore dévoile une dimension cachée
de la réalité.
L’oxymore efficace possède une
nécessité interne. Il ne résulte pas d’un simple
jeu de mots gratuit. Sa contradiction apparente révèle une
vérité plus profonde que la logique ordinaire ne
saurait exprimer. Cette révélation constitue sa véritable
valeur.
Un oxymore réussi génère également une émotion spécifique. Il produit un trouble, une interrogation, une révélation. Cette charge émotionnelle distingue l’oxymore artistique du simple rapprochement fortuit de mots contradictoires.
Questions fréquentes sur l’oxymore
Vous vous demandez souvent comment
identifier avec certitude un oxymore ? La réponse
tient dans la proximité immédiate des termes contradictoires. Si
les mots opposés sont séparés par plusieurs autres mots, il s’agit
probablement d’une autre figure de style.
L’oxymore doit-il toujours choquer ?
Non. Certains oxymores sont devenus si familiers
qu’ils ne surprennent plus. “Doux-amer”, “noir et blanc”,
“aigre-doux” appartiennent désormais au vocabulaire courant. Leur
origine oxymorique s’est estompée dans l’usage.
Peut-on créer ses propres oxymores ? Absolument. La créativité linguistique n’a pas de limites. Vous pouvez inventer des oxymores originaux à condition qu’ils révèlent une vérité nouvelle ou expriment une émotion authentique. L’originalité ne suffit pas : il faut aussi la pertinence sémantique.
Si vous doutez de l’orthographe d’un oxymore que vous créez, n’hésitez pas à utiliser notre correcteur d’orthographe pour vérifier la justesse de votre expression.
- Identifiez la contradiction : Les termes s’opposent-ils vraiment ?
- Analysez la proximité : Les mots contradictoires sont-ils contigus ?
- Cherchez le sens nouveau : Quelle signification émergente découvrez-vous ?
- Évaluez l’effet produit : L’oxymore révèle-t-il une vérité cachée ?
L’oxymore dans d’autres traditions linguistiques
L’oxymore transcende les
frontières linguistiques. Chaque culture développe ses propres
alliances paradoxales de mots. Cette universalité
révèle un besoin humain fondamental : exprimer les
complexités existentielles qui échappent à la
logique simple.
En anglais, “deafening silence”
(silence assourdissant) ou “living death” (mort vivante) illustrent
cette même tension créatrice. L’espagnol offre
“silencio elocuente” (silence éloquent), l’italien “dolce amaro”
(doux-amer). Chaque langue forge ses propres contradictions
révélatrices.
Cette convergence interculturelle suggère que l’oxymore répond à un besoin expressif universel. Il permet de saisir les paradoxes fondamentaux de l’existence humaine : la beauté tragique, la faiblesse forte, la lumière obscure qui éclaire nos vies.

























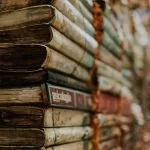

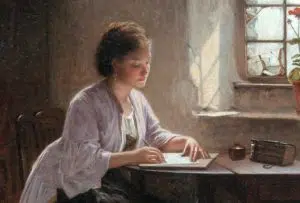
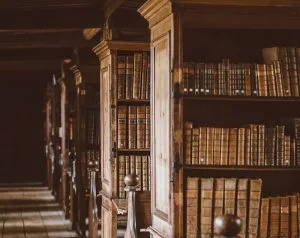
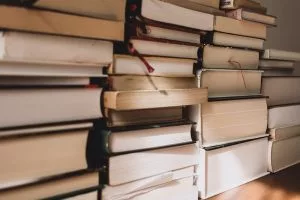







Très intéressant.
Je ne ne sais si nous avons le droit de poser des questions:
pouvons nous dire que la “Maison de la Nature” est un oxymore ?
Merci pour votre article.
un bon cours merci beaucoup pour votre cours parfait
HOSTIES NOIRES, SENGHOR
Bonjour,
Question qui me taraude : est-ce que le consentement présumé est un oxymore ?
Je vous remercie 🙂
De prime abord, pas vraiment… Il ne semble pas y avoir une contradiction évidente entre les deux termes.
Bonjour, l’expression usuelle “rester mobile” peut-elle être considérée comme un oxymore ?
Oui et non. “Rester”, en plus de “demeurer dans le lieu où l’on est”, signifie aussi “demeurer dans un même état”.
Très clair ! Merci.
Très intéressant merci
J’ai l’humble conviction que je ne doute pas de la certitude que la langue est merveille !
Bonsoir Adrian.
Ton article sur l’OXYMORE et plus généralement ta rubrique FIGURE DE STYLE sont des enseignements précis, simples et donc efficaces pour qui souhaite mémoriser ces différentes techniques littéraires. Un grand merci.
En exemple tu as, entre autres, cité NOTRE GENIE VICTOR HUGO, les CONTEMPLATIONS :
Je sais que c’est la coutume
D’adorer ces NAINS GEANTS
Qui, parce qu’ils sont écume
Se supposent océans ;
Magnifique non ? Splendide ! Lu à haute voix la beauté de ces vers en sont réhaussés. Et que dire du contenu ? La fond allié à la forme dans un français d’excellence.
Tes choix pour illustrer tes enseignements sont excellents.
Encore Merci.
Pasal
Explications très claires et détaillées. Merci
merci exemples precis ; ce n est pas du clair obscur§§§§§
Si je dis : cette nana, elle est bien. Est-ce un oxymore ??
salutations est ce que “je suis gentil que par méchanceté” peut être considéré comme un oxymore ?
Un oxymore que je trouve important car de parfaite mauvaise foi et mensonger: OPPOSITION CONSTRUCTIVE.
très très clair ! J’aime la richesse du (des) langage(s)
Merci
illumination de l’obscurité intellectuelle! merci
Excellent site qui laisse occis mais jamais mort. ??
je trouve sa complexe car je cherche un exemple simple d’un oxymore pour comprendre mais c’est vraiment compliquée a comprendre pour une élève de 4ème
“vocabulaire publique” ?? Plutôt “vocabulaire public”, non ?
Du coup, je me suis inscrite pour continuer (82 ans) à m’instruire…
Super. L’instruction est infinie
Profitez de votre futur.
Je voudrais savoir si le titre “contrôle de gestion” est un oxymore ou un pléonasme.
Merci de bien me répondre avec des explications
On peut considérer que “contrôle de gestion” est un pléonasme parce que la gestion est déjà une forme de contrôle. Mais c’est une expression usuelle.
Merci pour votre réponse,mais est ce que vous pouvez me donner plus d’explications parce que c’est un sujet à traiter que je dois rendre à mon prof.
Merci
La définition d’oxymore est trop longue fait les définitions plus courtes et surtout plus compréhensible !
Crier tout bas
Coeur de pirate
Merci pour cette explication , simple mais très riche d’exemples . J’ai 69ans mais j’aime apprendre , et tous les jours , je découvre . Merci encore à Adrian .
J’ai eu plaisir à vous lire chère congénère,
on est toutes les deux jeune vieille?
merci bonnes explications …
Très bien expliqué ! Beaucoup d’exemples ! Formidable
merci c est passionnant
Passionnant !
Très intéressant ! J’aime beaucoup
La France insoumise avec Mélenchon : Oxymore
Nouvel abonné, j’apprécie votre lettre hebdomadaire…Merci!
Merci j’ai trouvé l article très intéressant.
Merci j’ai trouvé l article très intéressant.
Merci François 😉