
⏳ Temps de lecture : 10 minutes
L’allégorie est une figure de style par laquelle on exprime, on représente une idée, une notion ou un thème par une métaphore, une personnification, une image ou, plus généralement, une forme concrète. En d’autres mots, l’allégorie est une représentation concrète d’une notion abstraite. Elle utilise un symbole (un texte, une image, etc.) qui véhicule une notion. À l’écrit, on la repère souvent par l’utilisation de la majuscule. L’allégorie a donc deux sens : un sens littéral (la forme qui représente l’idée) et un sens figuré (l’idée, la notion qui est représentée). Exemple :
Le Temps mange la vie,
Et l’obscur Ennemi qui nous ronge le coeur
Du sang que nous perdons croît et se fortifieBaudelaire, Fleurs du mal, L’Ennemi
Baudelaire représente une notion abstraite, le temps qui fuit, de manière concrète, comme un monstre qui dévore la vie de l’homme. Il y a donc, en outre, une personnification du temps. Personnification et allégorie vont souvent de pair. L’allégorie du temps qui fuit (tempus fugit) est un lieu commun de la littérature. Autre exemple :
Je vis cette faucheuse. Elle était dans son champ.
Elle allait à grands pas moissonnant et fauchant,
Noir squelette laissant passer le crépuscule.Hugo, Contemplations, Mors
La faucheuse est ici l’allégorie de la mort. On peut dire en même temps que la mort est personnifiée en faucheuse.
Exemple d’allégorie visuelle :

L’oncle Sam représenté ci-dessus est devenu l’allégorie des États-Unis d’Amérique. On utilise d’ailleurs souvent la périphrase « l’oncle Sam » pour parler des États-Unis.
L’allégorie, une figure d’analogie
L’allégorie permet de rendre plus compréhensibles ou plus palpables des notions abstraites. Elle permet en outre des rapprochements surprenants et séduisants entre des idées et des éléments concrets. L’allégorie est souvent développée tout au long d’un texte, ou d’une œuvre entière, comme dans les Fables de La Fontaine.
Allégorie et proverbes
Les proverbes se rapprochent des catachrèses dans la mesure où ce sont des allégories qui ont un sens littéral, mais qui décrivent une réalité absurde. Il faut imaginer directement le message abstrait derrière ces symboles. Exemples :
- Pierre qui roule n’amasse pas mousse.
- Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se brise.
- Qui va à la chasse, perd sa place.
Étymologie d’allégorie
Allégorie vient du grec allos, ἄλλος, « autre », et agoreo, ἀγορεύω, « je parle » ce qui donne : « je parle par l’autre » ou « je parle par autre chose ». On parle d’une chose en suggérant autre chose.
Exemples d’allégories

De nombreux titres de livres contiennent des allégories :
- Mars ou la guerre jugée : le dieu de la guerre Mars est bien sûr l’allégorie de la guerre.
- La Peste de Camus : la peste représente l’occupation.
- Le Rouge et le Noir : le titre est énigmatique. On interprète souvent le rouge comme le symbole de l’armée, et le noir comme celui du clergé.
La France est une mère dont les deux enfants, Esaü et Jacob, se battent pour la vie. Agripa d’Aubigné, auteur protestant, dénonce par cette allégorie la guerre civile religieuse qui frappe la France du XVIe siècle.
Je veux peindre la France une mère affligée,
Qui est, entre ses bras, de deux enfants chargée.
Le plus fort, orgueilleux, empoigne les deux bouts
Des tétins nourriciers ; puis, à force de coups
D’ongles, de poings, de pieds, il brise le partage
Dont nature donnait à son besson l’usage ;
Ce voleur acharné, cet Esaü malheureux,
Fait dégât du doux lait qui doit nourrir les deux,
Si que, pour arracher à son frère la vie,
Il méprise la sienne et n’en a plus d’envie.
Mais son Jacob, pressé d’avoir jeûné meshui,
Ayant dompté longtemps en son cœur son ennui,
À la fin se défend, et sa juste colère
Rend à l’autre un combat dont le champ est la mère.
Ni les soupirs ardents, les pitoyables cris,
Ni les pleurs réchauffés ne calment leurs esprits ;
Mais leur rage les guide et leur poison les trouble,
Si bien que leur courroux par leurs coups se redouble.
Leur conflit se rallume et fait si furieux
Que d’un gauche malheur ils se crèvent les yeux.
Cette femme éplorée, en sa douleur plus forte,
Succombe à la douleur, mi-vivante, mi-morte ;
Elle voit les mutins tout déchirés, sanglants,
Qui, ainsi que du cœur, des mains se vont cherchant.
Quand, pressant à son sein d’une amour maternelle
Celui qui a le droit et la juste querelle,
Elle veut le sauver, l’autre qui n’est pas las
Viole en poursuivant l’asile de ses bras.
Adonc se perd le lait, le suc de sa poitrine ;
Puis, aux derniers abois de sa proche ruine,
Elle dit : « Vous avez, félons, ensanglanté
Le sein qui vous nourrit et qui vous a porté ;
Or vivez de venin, sanglante géniture,
Je n’ai plus que du sang pour votre nourriture !Agrippa d’Aubigné, Les Tragiques, I, v.97-130.
Autres exemples :
Quand vous voyez quelquefois un nombreux troupeau qui, répandu sur une colline vers le déclin d’un beau jour, paît tranquillement le thym et le serpolet, ou qui broute dans une prairie une herbe menue et tendre qui a échappé à la faux du moissonneur, le berger, soigneux et attentif, est debout auprès de ses brebis ; il ne les perd pas de vue, il les suit, il les conduit, il les change de pâturages ; si elles se dispersent, il les rassemble ; si un loup avide paraît, il lâche son chien qui le met en fuite ; il les nourrit, il les défend ; l’aurore le trouve déjà en pleine campagne, d’où il ne se retire qu’avec le soleil. Quels soins ! quelle vigilance ! quelle servitude ! Quelle condition vous paraît la plus délicieuse et la plus libre, ou du berger, ou des brebis ? Le troupeau est-il fait pour le berger, ou le berger pour le troupeau ? Image naïve des peuples et du prince qui les gouverne, s’il est bon prince !
La Bruyère, Les Caractères, Le Berger et le Troupeau
La vie humaine est semblable à un chemin dont l’issue est un précipice affreux. On nous en avertit dès les premiers pas, mais la loi est portée : il faut avancer toujours, je voudrais retourner en arrière… Marche, marche. Un poids invincible, une force irrésistible nous entraîne : il faut sans cesse avancer vers le précipice. Mille traverses, mille peines nous fatiguent, et nous inquiètent sur la route. Encore si je pouvais éviter ce précipice affreux !… Non, non, il faut marcher, il faut courir. Telle est la rapidité des années. On se console pourtant, parce que de temps en temps on rencontre des objets qui vous divertissent, des eaux courantes, des fleurs qui passent : on voudrait s’arrêter… Marche, marche. Et cependant on voit tomber derrière soi tout ce qu’on avait passé : fracas effroyable ! inévitable ruine ! On se console, parce qu’on emporte quelques fleurs cueillies en passant, qu’on voit se faner entre ses mains du matin au soir, et quelques fruits qu’on perd en les goûtant : enchantement ! illusion ! Toujours entraîné, on approche du gouffre affreux ; déjà tout commence à se ternir ; les jardins sont moins fleuris, les fleurs moins brillantes, leurs couleurs moins vives, les prairies moins riantes les eaux moins claires ; tout pâlit, tout s’efface ; l’ombre de la mort se présente ; on commence à sentir l’approche du gouffre fatal ; mais il faut aller sur le bord ; encore un pas : déjà l’horreur trouble les sens, la tête tourne, les yeux s’égarent… il faut marcher ; on voudrait retourner en arrière ; plus de moyens : tout est évanoui, tout est tombé, tout est échappé.
Bossuet, Sermon pour le jour de Pâques
La domination maritime de l’Angleterre est représentée concrètement par l’allégorie du vaisseau :
L’Angleterre est un vaisseau. Notre île en a la forme : la proue tournée au nord, elle est comme à l’ancre au milieu des mers, surveillant le continent.
De Vigny, III, Chatterton, 6, Chatterton
L’aigle personnifié est ici l’allégorie du conquérant impérial : Napoléon.
Il neigeait. On était vaincu par sa conquête.
Pour la première fois l’aigle baissait la tête.
Sombres jours ! l’empereur revenait lentement,
Laissant derrière lui brûler Moscou fumant.Hugo, Les Châtiments, Expiation
— C’est alors
Qu’élevant tout à coup sa voix désespérée,
La Déroute, géante à la face effarée
Qui, pâle, épouvantant les plus fiers bataillons,
Changeant subitement les drapeaux en haillons,
À de certains moments, spectre fait de fumées,
Se lève grandissante au milieu des armées,
La Déroute apparut au soldat qui s’émeut,
Et, se tordant les bras, cria : Sauve qui peut !
Sauve qui peut ! — affront ! horreur ! — toutes les bouches
Criaient ; à travers champs, fous, éperdus, farouches,
Comme si quelque souffle avait passé sur eux,
Bon chevalier masqué qui chevauche en silence,
Le Malheur a percé mon vieux coeur de sa lance.Le sang de mon vieux coeur n’a fait qu’un jet vermeil,
Puis s’est évaporé sur les fleurs, au soleil.L’ombre éteignit mes yeux, un cri vint à ma bouche
Et mon vieux coeur est mort dans un frisson farouche.Alors le chevalier Malheur s’est rapproché,
Il a mis pied à terre et sa main m’a touché.Son doigt ganté de fer entra dans ma blessure
Tandis qu’il attestait sa loi d’une voix dure.Et voici qu’au contact glacé du doigt de fer
Un coeur me renaissait, tout un coeur pur et fierEt voici que, fervent d’une candeur divine,
Tout un coeur jeune et bon battit dans ma poitrine !Or je restais tremblant, ivre, incrédule un peu,
Comme un homme qui voit des visions de Dieu.Mais le bon chevalier, remonté sur sa bête,
En s’éloignant, me fit un signe de la têteEt me cria (j’entends encore cette voix) :
” Au moins, prudence ! Car c’est bon pour une fois. “Verlaine, Sagesses
Le Vaisseau d’Or est l’allégorie du destin de l’auteur, et une métaphore de son génie créateur.
C’était un grand Vaisseau taillé dans l’or massif :
Ses mâts touchaient l’azur, sur des mers inconnues;
La Cyprine d’amour, cheveux épars, chairs nues,
S’étalait à sa proue, au soleil excessif.Mais il vint une nuit frapper le grand écueil
Dans l’Océan trompeur où chantait la Sirène,
Et le naufrage horrible inclina sa carène
Aux profondeurs du Gouffre, immuable cercueil.Ce fut un Vaisseau d’Or, dont les flancs diaphanes
Révélaient des trésors que les marins profanes,
Dégoût, Haine et Névrose, entre eux ont disputés.Que reste-t-il de lui dans la tempête brève ?
Qu’est devenu mon coeur, navire déserté ?
Hélas! Il a sombré dans l’abîme du Rêve !Émile Nellgan, Le Vaisseau d’or
Mon beau navire ô ma mémoire
Avons-nous assez navigué
Dans une onde mauvaise à boire
Avons-nous assez divagué
De la belle aube au triste soirApollinaire, Chanson du mal aimé
La rêverie…une jeune femme merveilleuse, imprévisible, tendre, énigmatique, provocante, à qui je ne demande jamais compte de ses fugues.
A. Breton, Farouche à quatre feuilles, cité par le Gradus
Chez Baudelaire
Ô Mort, vieux capitaine, il est temps ! levons l’ancre !
Ce pays nous ennuie, ô Mort ! Appareillons !
Si le ciel et la mer sont noirs comme de l’encre,
Nos coeurs que tu connais sont remplis de rayons !Fleurs du Mal, Le voyage
C’est une femme belle et de riche encolure,
Qui laisse dans son vin traîner sa chevelure.
Les griffes de l’amour, les poisons du tripot,
Tout glisse et tout s’émousse au granit de sa peau.
Elle rit à la mort et nargue la Débauche,
Ces monstres dont la main, qui toujours gratte et fauche,
Dans ses jeux destructeurs a pourtant respecté
De ce corps ferme et droit la rude majesté.
Elle marche en déesse et repose en sultane ;
Elle a dans le plaisir la foi mahométane,
Et dans ses bras ouverts, que remplissent ses seins,
Elle appelle des yeux la race des humains.
Elle croit, elle sait, cette vierge inféconde
Et pourtant nécessaire à la marche du monde,
Que la beauté du corps est un sublime don
Qui de toute infamie arrache le pardon.
Elle ignore l’Enfer comme le Purgatoire,
Et quand l’heure viendra d’entrer dans la Nuit noire,
Elle regardera la face de la Mort,
Ainsi qu’un nouveau-né, – sans haine et sans remord.Allégorie
Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle
Sur l’esprit gémissant en proie aux longs ennuis,
Et que de l’horizon embrassant tout le cercle
II nous verse un jour noir plus triste que les nuits ;Quand la terre est changée en un cachot humide,
Où l’Espérance, comme une chauve-souris,
S’en va battant les murs de son aile timide
Et se cognant la tête à des plafonds pourris ;Quand la pluie étalant ses immenses traînées
D’une vaste prison imite les barreaux,
Et qu’un peuple muet d’infâmes araignées
Vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux,Des cloches tout à coup sautent avec furie
Et lancent vers le ciel un affreux hurlement,
Ainsi que des esprits errants et sans patrie
Qui se mettent à geindre opiniâtrement.– Et de longs corbillards, sans tambours ni musique,
Défilent lentement dans mon âme ; l’Espoir,
Vaincu, pleure, et l’Angoisse atroce, despotique,
Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir.Spleen LXXVIII
La mort

La figure de la faucheuse symbolise bien sûr la mort qui prend les soldats de la Première Guerre mondiale en masse.

Les vanités, expression que l’on retrouve dans l’Ecclésiaste, sont des compositions qui associent des objets de pouvoirs ou de plaisirs à d’autres objets symbolisant la mort. L’analyse de celle-ci est aisée : la fleur, ravissante, mais qui se fanera, le crâne d’un homme, et le sablier qui symbolise le temps qui s’écoule.
La justice

Une allégorie représentant les symboles traditionnels : la balance, le glaive (l’application des peines). Ici, toutefois, la Justice est nue et elle n’est pas aveugle.
La liberté et de la démocratie

Ce tableau est devenu un symbole en lui-même de la liberté. Il “parle pour lui-même”. Marianne, au centre, est l’allégorie de la France.

La Liberté éclairant le monde, à New York, symbolise la liberté et l’émancipation qu’offraient les États-Unis aux migrants qui venaient s’y installer. Elle symbolise aussi les États-Unis. Cadeau de la France aux Américains, elle peut aussi incarner l’amitié qui lie ces deux peuples.
L’amour

Allégorie de l’amour, Cupidon et Psyché, Francisco de Goya. Le dieu Cupidon est le dieu de l’amour.
Le temps

On voit ici les trois âges de la vie, associés chacun à un animal, le loup, le lion et le chien. Ces trois têtes d’animaux seraient un symbole de la prudence. Ce tableau est aussi une allégorie de cette vertu cardinale chez les chrétiens, comme le confirment les maximes latines inscrites au-dessus des visages des trois personnages (de gauche à droite) : ex praeterito praesens prudenter agit ni futur actione deturpet ( informé du passé, le présent agit avec prudence, de peur qu’il n’ait à rougir de l’action future).
L’angoisse

Au-delà du personnage, dont la morphologie est étrange (peut-être inspiré des momies péruviennes vues par Munch au cours d’une exposition parisienne), le tableau nous enroulent dans d’étranges tourbillons de couleurs vives, qui renforcent une sensation de malaise.
































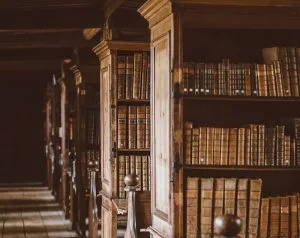

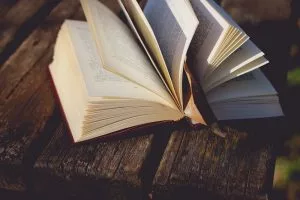
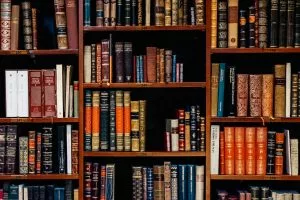

waw
Merci. Lire ces articles m’a permis de revoir mes figures de style.
c’est un riche article. Ceci me permettre d’entament des débats avec mes élves´dans le cours de pratique de la langue