
⏳ Temps de lecture : 7 minutes
“Ce que je sais, c’est que je ne sais rien” est une citation est attribuée à quelqu’un qui n’a jamais écrit une seule ligne : Socrate (470 – 399 av. J.-C.), un Athénien qui semble avoir passé une bonne partie de sa vie à parler de questions morales avec ses concitoyens et les jeunes aristocrates d’Athènes. Au sens strict, le célèbre mot de Socrate « ce que je sais, c’est que je ne sais rien » nous vient de son disciple Platon (427 – 348 av. J.-C.), immense philosophe qui a mis en scène son maître dans des dialogues (une autre source importante à propos de Socrate est Xénophon [440 – 355 av. J.-C.], moins connu malgré ses Mémorables). Il est toujours difficile de savoir ce qui, dans les mots que Platon prête à Socrate, provient du Socrate historique. Notre citation fait partie des quelques idées que l’on peut attribuer à ce dernier avec une forte probabilité car on la trouve dans des textes de jeunesse de Platon (Apologie de Socrate et Ménon), réputés les plus proches de la pensée socratique. Cette idée se maintient en outre jusque dans les écrits de la maturité, notamment dans le Sophiste, où elle est défendue par un énigmatique et pénétrant personnage, « L’étranger d’Elée », signe qu’elle a trouvé une place toute particulière, et d’une certaine manière centrale, dans la pensée de Platon.
Ce que je sais, c’est que je ne sais rien : explication
Pourquoi donc Socrate, réputé si sage, maître de l’un des plus grands philosophes de l’histoire et capable de tenir tête à tous les intellectuels de son époque, affirme-t-il que « ce que je sais, c’est que je ne sais rien » ? Une petite anecdote, racontée par Socrate lui-même lors de son procès et rapportée par Platon dans son Apologie de Socrate nous permet de comprendre d’où lui vient cette idée. Socrate, alors qu’il essaye de se défendre des accusations portées contre lui, s’interroge : pourquoi me suis-je fait autant d’ennemis ? pourquoi toutes ces calomnies contre moi ?
[Chéréphon, un ami], un jour qu’il était allé à Delphes, eut l’audace de poser à l’oracle la question que voici – et je vous en prie, encore une fois, n’allez pas vous exclamer, Athéniens : oui, il demanda s’il existait un homme plus sage que moi. Eh bien ! la Pythie* répondit que nul n’était plus sage.
Apologie de Socrate, 20e-21a
La Pythie est l’oracle d’Apollon
Pour comprendre ce singulier oracle, Socrate décide de mener l’enquête. Il part rencontrer et interroger tous ceux qui étaient réputés les plus « sages » (σοφοί, sophoi) de son époque : sophistes, philosophes, hommes politiques, poètes et même les artisans. On pourrait être étonné de voir les artisans comptés aux nombre des sages. C’est que le terme grec σοφία (sophia) est plus large que notre terme « sagesse ». Son usage le plus ancien et commun désigne tout simplement une compétence, la plupart du temps pratique. Être σοφός (sophos), c’est avant tout maîtriser un savoir. À chaque fois, au sortir de son entretien, il tire la même conclusion :
Cet homme-là, moi, je suis plus sage que lui. Car il y a certes des chances qu’aucun de nous deux ne sache rien de beau ni de bon ; mais lui croit savoir quelque chose, alors qu’il ne sait rien, tandis que moi, si je ne sais rien, je ne crois pas non plus savoir. Je me fais du moins l’effet d’être plus sage que cet homme justement par ce mince avantage, que ce que je ne sais pas, je ne crois pas non plus le savoir.
Apologie de Socrate, 21d
Voilà donc le secret de cette sagesse socratique qui est « une sagesse d’homme (ἀνθρωπίνη σοφία, anthrôpinè sophia) » (20e) : se savoir ignorant, alors que les autres se croient savants. On peut comprendre ainsi pourquoi Socrate est entouré de jeunes disciples. Malgré des attitudes parfois affirmatives et péremptoires, les jeunes gens sont souvent moins sûrs d’eux que les hommes plus âgés, convaincus par leur expérience de saisir l’ordre du monde et de savoir ce qui est bel et bon. On peut comprendre aussi pourquoi Socrate s’est fait tant d’ennemis : voir son ignorance révélée au grand jour n’est jamais très agréable, surtout quand on est considéré par les autres et qu’on se considère soi-même comme compétent et savant.
Socrate : une torpille
C’est pourquoi Socrate, dans le Ménon, se trouve comparé par son interlocuteur à une torpille, ce poisson qui se défend en envoyant des secousses électriques : « tu me fais totalement l’effet, pour railler ainsi un peu, de ressembler au plus haut point, tant par son aspect extérieur que par le reste, à une torpille, ce poisson de mer tout aplati » (Ménon, 80a). Discuter avec Socrate est une expérience désagréable parce que ses questions nous poussent à prendre conscience de notre ignorance, et cette conscience ne nous plaît pas. Mais attention, répond Socrate, la comparaison ne tient que si la torpille elle-même subit le désagrément qu’elle cause aux autres :
Quant à moi, si la torpille se met elle-même dans un tel état de torpeur quand elle y met aussi les autres, je lui ressemble. Sinon, je ne lui ressemble pas. Car ce n’est pas parce que je suis moi-même à l’aise que je mets les autres dans l’embarras, au contraire, c’est parce que je me trouve moi-même dans un extrême embarras que j’embarrasse ainsi les autres. Tu vois bien qu’à présent, parlant de la vertu, je ne sais pas ce qu’elle est, tandis que toi, qui le savais sans doute avant d’entrer en contact avec moi, tu ressembles tout de même maintenant à quelqu’un qui ne le sait pas ! Cependant, je veux bien mener cet examen avec toi, pour que nous recherchions ensemble ce que peut bien être la vertu.
Ménon, 80c-d
On voit ainsi se dessiner deux conséquences importantes de la sagesse socratique. Tout d’abord, elle nous met tous dans un état de malaise et d’insatisfaction. Nous avons naturellement le désir de connaître, et pourtant nous nous rendons compte que nous ne connaissons rien. Un désir inassouvi, béant, se révèle ainsi en notre esprit et le met dans un embarras profond. Cet état est désigné en grec par le verbe ἀπορεῖν (aporein), qui a donné le terme français « aporie », qui désigne une contradiction insoluble, une impasse, un point où aucun chemin ni aucune solution ne semble se dessiner.
Par ailleurs, cette ignorance consciente ou « docte ignorance » ouvre la voie au dialogue plutôt qu’au grand discours. En reconnaissant que ce que nous cherchons nous dépasse tous, nous nous rendons compte qu’il vaut mieux chercher ensemble, c’est-à-dire tourner ensemble nos ignorances dans la même direction, plutôt que d’accaparer l’attention des autres au profit de notre seul chemin partiel. En ce sens, le choix platonicien de la forme dialoguée est loin d’être anodin.
Dans le Sophiste, c’est l’étranger d’Elée qui défend la sagesse socratique. Il commence par remarquer que l’ignorance de son ignorance est certainement l’archétype de toutes les ignorances et la mère de toutes les erreurs : « Je crois voir une grande et fâcheuse espèce d’ignorance, distincte des autres, et égale à elle seule à toutes les autres. […] C’est de croire qu’on sait quelque chose, alors qu’on ne le sait pas. C’est de là, je le crains, que viennent toutes les erreurs où notre pensée à tous est sujette. » (Sophiste, 229b-c)
Devenir un docte ignorant
Comment peut-on se débarrasser de cette ignorance originelle, c’est-à-dire acquérir la sagesse socratique ? Par ce qui s’apparente à une purification de l’âme : la παιδεία (paideia), terme grec difficile à traduire (comme sophia), qui désigne la culture et l’éducation en un sens à la fois théorique et concret, orientées vers une idée d’excellence.
C’est donc par l’éducation que l’on peut espérer être purifié de l’ignorance de sa propre ignorance. Mais Platon ne croit pas en l’éducation « à l’ancienne », qui marche par punitions et récompenses. Il défend à la place une nouvelle éducation, fondée sur le dialogue. Par définition, celui qui ignore qu’il ignore croit savoir. Or, celui qui croit savoir ne ressent pas le désir d’apprendre. Comment donc l’éduquer ? C’est en se posant cette question que Platon écrit l’une des plus belles pages de l’histoire de la pédagogie :
certains sont venus, après mûre réflexion, à penser que l’ignorance est toujours involontaire et que celui qui se croit sage ne consentira jamais à apprendre aucune des choses où il s’imagine être savant, et que, par suite, tout en prenant beaucoup de peine, le genre d’éducation qu’est la punition aboutit à de médiocres résultats. […]
[Ainsi, à la place,] ils questionnent leur homme sur les choses où il croit parler sensément. Alors qu’il ne dit rien de valable et s’égare, il leur est facile de reconnaître ses opinions ; ils les ramassent ensemble dans leur critique, les confrontent les unes avec les autres et font voir ainsi qu’elles se contredisent sur les mêmes objets, sous les mêmes rapports et des mêmes points de vue. Ceux qui se voient ainsi confondus sont mécontents d’eux-mêmes et deviennent doux envers les autres, et cette épreuve les délivre des opinions orgueilleuses et cassantes qu’ils avaient d’eux-mêmes, ce qui est de toutes les délivrances la plus agréable à apprendre et la plus sûre pour celui qu’elle concerne. C’est que, mon cher enfant, ceux qui les purifient pensent comme les médecins du corps. Ceux-ci sont convaincus que le corps ne saurait profiter de la nourriture qu’on lui donne, avant qu’on n’en ait expulsé ce qui l’embarrasse. Ceux-là ont jugé de même que l’âme ne saurait tirer aucune utilité des connaissances qu’on lui donne, jusqu’à ce qu’on la soumette à la critique, qu’en la réfutant on lui fasse honte d’elle-même, qu’on lui ôte les opinions qui font obstacle à l’enseignement, qu’on la purifie ainsi et qu’on l’amène à reconnaître qu’elle ne sait que ce qu’elle sait et rien de plus.
Sophiste, 230a-d
La sagesse socratique, conscience de notre ignorance et des limites de notre savoir, se présente donc comme un préalable à toute recherche de la vérité. Il faut d’abord se reconnaître ignorant pour pouvoir partir en quête de ce qui est réellement, par-delà les illusions du monde. Cette prise de conscience du vide qui nous habite possède une étonnante force motrice. À l’inverse, celui qui croit savoir ne se met en quête de rien. Dans le Théétète, un dialogue écrit à la même époque que le Sophiste, Socrate se compare à une accoucheuse, femme qui n’est plus en âge d’être enceinte mais aide les jeunes femmes à mettre au monde leur enfant. À l’image de ces maïeuticiennes (Maïa était la déesse qui veillait aux accouchements, et la maïeutique est l’art de faire accoucher les pensées par le dialogue), Socrate affirme qu’il ne peut plus produire de savoir mais peut seulement aider les jeunes hommes qui, plein d’un savoir à naître, sont dans les affres de l’enfantement. C’est parce qu’il est lui-même vide de savoir qu’il est entièrement au service des autres. Conscient de son absence de savoir, il l’utilise pour pousser les autres vers le savoir.
Peut-on dire que cette citation témoigne d’une forme de scepticisme (c’est-à-dire qu’elle reflète l’opinion selon laquelle l’homme ne peut rien savoir avec certitude) ? Pas vraiment. Tout d’abord « je sais » quelque chose : que je ne sais rien. Il y a donc au moins un savoir certain. Par ailleurs, « je ne sais rien », certes, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a rien à savoir. Mon ignorance a une origine subjective et contingente, elle est factuelle : c’est parce que je m’attache à des erreurs, des opinions fausses, des illusions, c’est-à-dire à tout ce qui est le plus bruyant en notre monde, que je m’égare. Mais en droit et dans l’absolu, il y a bien quelque chose à savoir et certains ont la capacité de le saisir (ceux que Platon appelle les « naturels philosophes »). Cependant, ce qui est objet du savoir véritable nous dépasse la plupart du temps.
C’est l’un des grands efforts de Platon que d’essayer de concevoir les moyens qui nous permettraient de nous hisser jusqu’à cela même qui nous dépasse.
À lire
- Platon, Apologie de
Socrate
- Ménon
- Théétète
- Sophiste
- (Nous conseillons la traduction de L. Robin, hélas surtout disponible en Pléiade, ou, pour le Sophiste, la traduction de L. Mouze)
- Francis Wolff, Socrate, PUF, Paris, 1987









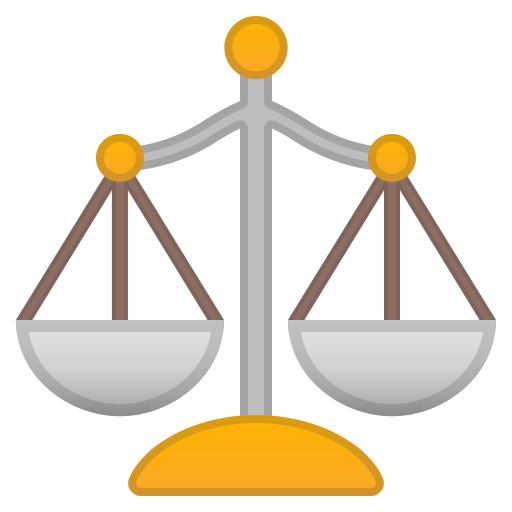









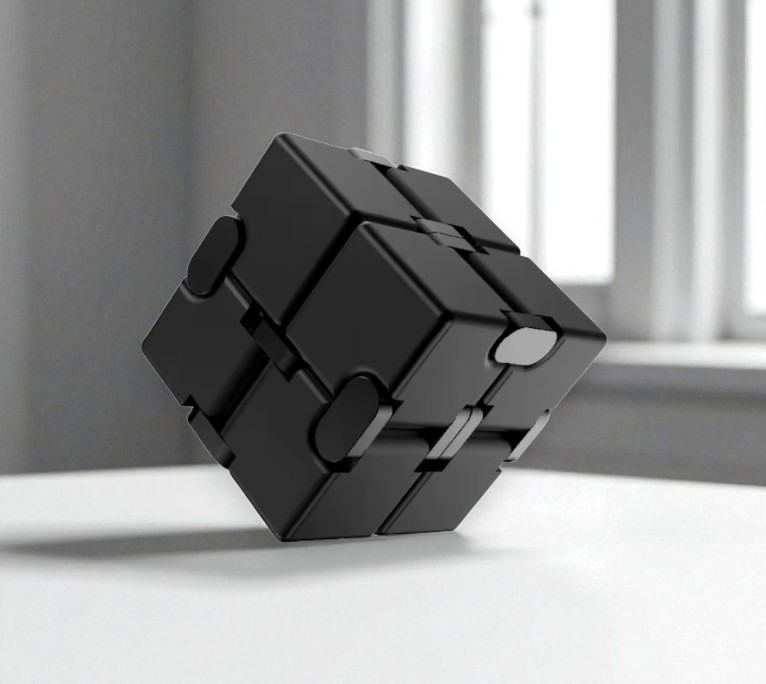
















MERCIS POUR VOTRE AIDE
Ce je sais c’est que je ne sais rien
Se tellement beau
Je dirais que cette phrase a une posture acataleptique dans la mesure où s’il a conscience de savoir, il sait que ce savoir est évolutif au gré des découvertes scientifiques mais également de sa propre compréhension du passé (par l’histoire) et du présent (par la conversation et l’introspection). En d’autres termes, il sait que la vérité n’est pas atteignable et limite son savoir à la réalité, changeante par nature.
Ce que je sais c’est que je ne sais pas
Faire et défaire, du mouvement sain, s
Superbe lecture : notre inconscient, et nos prises de conscience . Merci.
PS: Après avoir controlé sur le texte original, tout change, car j’aurais compris, encore que, que Socrate puisse dire: “tandis que moi, si je ne sais rien, je ne crois pas non plus savoir.” mais jamais “Ce que je sais, c’est que je ne sais rien” .Par contre:
[…certainement], je ne sais PAS, et je n’ai pas la presomption (de savoir)”[…]. La différence est ‘rien’, car ‘pas’ et ‘rien’ ne sont pas du pareil au meme. Ce n’est pas rien! Apologie de Socrate, 21d
Socrate adorant la discussion, il ne m’en voudra donc pas d’etre en désaccord avec “Ce que je sais, c’est que je ne sais rien”, car si nous utilisons à peine un dixième à peu près, voire moins, de nos neurons, Albert Einstein dixit, quelque chose, on sait, meme peu, mais pas complètement rien. Par contre, par contre, à mon avis et au sien, bien entendu, ce qui est vrai et très vrai et pour tous, meme, je pense, pour Freud, lui-meme, c’est ce que Socrate dit dans Phèdre: ” […]Je ne suis pas capable de connaitre moi-meme comme il est écrit sur le fronton du temple de Delphes, donc il me semble ridicule, ne me connaissant pas encore moi-meme, de me mettre à la recherche de choses qui me sont étrangères.[…]”. Le reve serait d’assister à une discussion entre Socrate, Freud et Einstein. Un trio vainqueur. Un vrai bonheur! monique
Bonjour,
“Socrate adorant la discussion” !?
“adorer”, ce serait pas excessif ?
Et ne serait pas, plutôt, le questionnement (que la discussion) ?
J’ai une théorie mais je ne sais pas si j’ai raison
“car si nous utilisons à peine un dixième à peu près, voire moins, de nos neurones” c’est pas tout à fait exact, les gens pensent à tord que nous n’utilisons que 10% du cerveau et que 90% ne servirait donc pas, ce n’est pas le cas, nous utilisons environ 10% de notre cerveau à l’instant T et les zone d’utilisation changent en permanence. En gros nous utilisons 100% de notre cerveau au fil du temps et environ 10% des zones cérébrales à l’instant T.
Merci pour cette belle étude du sujet et cette reprise de plusieurs textes !