
⏳ Temps de lecture : 4 minutes
Définition
Une anacoluthe est une figure de style par laquelle on opère volontairement (on le suppose…) une rupture dans la syntaxe. La construction grammaticale de la phrase est transformée pour lui donner un effet rhétorique. C’est une faute maîtrisée. La phrase se dirige vers le point vers lequel on l’attend, avant de prendre brusquement une autre direction. Elle est comme interrompue dans son cheminement.
Exemple
« Le nez de Cléopâtre, s’il eût été plus court, la face du monde en eût été changée. » (Pascal, Pensées, 392). Dans cette phrase, le verbe aurait dû avoir “le nez” pour sujet. Le sujet “La face du monde” apparaît sans qu’on l’attende. Pascal veut surprendre en exprimant un saut intellectuel par cette étrange syntaxe : l’histoire a été comme modifiée par le nez de Cléopâtre ! Pascal, mathématicien de génie, établit un parallèle implicite entre deux longueurs : la taille du nez de Cléopâtre et la face du monde. On le comprend : l’anacoluthe est fréquente dans le langage parlé.
Autre exemple : « Il a tout refusé, mais la noblesse de Rennes et de Vitré l’ont élu malgré lui » (Madame de Sévigné, Lettres). Dans cette phrase, le sujet est au singulier (la noblesse de Rennes et de Vitré) mais le verbe est au pluriel.
Les 36 figures de style essentielles de la langue franaçaise
Effet de l’anacoluthe
L’anacoluthe permet de faire primer le sens sur la grammaire. Elle permet bien sûr de faire passer des émotions, des tourments, mais aussi de la surprise ! Elle permet surtout de faire ressortir dans la forme du texte la rupture sur laquelle veut insister l’auteur. La phrase, qui s’arrête en chemin pour prendre une autre direction, se rapproche alors du fil des pensées tel qu’il se déroule réellement.
Anacoluthe et l’anantapodoton
L’anantapodoton est une variante d’anacoluthe dans laquelle un des termes d’une expression alternative (soit…soit ; ou…ou ; d’une part…d’autre part, etc.) manque. Exemple : « D’une part, tu vas te taire. ». On attendrait que la phrase se poursuive avec un “d’autre part”.
Étymologie d’anacoluthe
Anacoluthe vient du privatif grec an, et de acoulouthos, suiveur, compagnon. Anacoluthe signifie littéralement “qui ne suit pas”.
Exemples d’anacoluthes
Exemples cités par le Gradus :
- Elle berce et sourit à son
enfant.
On aurait pu écrire : “Elle berce son enfant et lui sourit”.
- Le roman n’est pas pressé comme
au théâtre.
On aurait pu écrire “comme le théâtre”.
Le vieillard eut raison l’un des trois jouvenceaux
Se noya dès le port, allant à l’Amérique ;
L’autre, afin de monter aux grandes dignités,
Dans les emplois de Mars servant la République,
Par un coup imprévu vit ses jours emportés ;
Le troisième tomba d’un arbre
Que lui-même il voulut enter;
Et pleurés du vieillard, il grava sur leur marbre
Ce que je viens de raconter.La Fontaine, Fables, Le Vieillard et les trois jeunes hommes
On aurait plutôt attendu que La Fontaine continue de parler des jeunes hommes (à qui “pleurés” s’applique). Mais l’auteur poursuit avec le “il” du vieillard comme sujet.
Et moi, pour trancher court toute cette dispute,
Il faut qu’absolument mon désir s’exécute.Molière, Les Femmes savantes, V, 4, Philaminte
La phrase commence par “Et moi”. Ce n’est pourtant pas le sujet de la phrase, qui se concentre sur le “désir” de Philaminte.
Vous voulez que ce Dieu vous comble de bienfaits,
Et ne l’aimer jamais ?Racine, Athalie, I, 4, Une autre voix
Racine utilise l’indicatif dans la première partie de sa phrase, puis l’infinitif.
Et vous, qui lui devez des entrailles de père,
Vous, ministre de paix dans les temps de colère,
Couvrant d’un zèle faux votre ressentiment,
Le sang à votre gré coule trop lentement ?II, 5
Il est a priori difficile de déterminer le sujet du participe présent “couvrant”, qui s’applique finalement à “le sang”.
O ciel ! plus j’examine, et plus je le regarde…
C’est lui ! D’horreur encore tous mes sens sont saisis.
Épouse de Joad, est-ce là votre fils ?II, 7
Ce Dieu, depuis longtemps votre unique refuge,
Que deviendra l’effet de ses prédictions?II, 9
Ma foi sur l’avenir bien fou qui se fiera.
Les Plaideurs, I, 4
Je t’aimais inconstant, qu’aurais-je fait fidèle ?
Andromaque, IV, 4, Hermione
“Inconstant” et “Fidèle” renvoient tous les deux à ” t’ ” et pas à “je”.
Le Poète est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l’archer ;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l’empêchent de marcher.Baudelaire, Fleurs du mal, L’Albatros
On attendait plutôt un sujet au singulier (“Le Poète”), mais Baudelaire nous donne “ses ailes de géant”. Cette rupture syntaxique reflète la rupture qu’opère le poète avec la société.
Chaque soir, espérant des lendemains épiques,
L’azur phosphorescent de la mer des Tropiques
Enchantait leur sommeil d’un mirage doré ;Heredia, Les Conquérants
Espérant ne renvoie pas à “l’azur phosphorescent”, comme pourrait le laisser penser la phrase dans un premier temps.
Les autres éternellement sur nous, j‘étouffe !
Claudel, Première journée, Don Camille
Ils font un barouf au comptoir, que je suis forcé de dominer.
Céline, Guignol’s Band
Comprenne qui voudra
Moi mon remords ce fut
La malheureuse qui resta
Sur le pavé
La victime raisonnableÉluard, Au Rendez-vous allemand, Comprenne qui voudra
Lui qui aimait tant ses aises, une veste n’importe comment, un vieux pantalon, il n’aimait que ça, les vieux vêtements.
N. Sarraute, Le planétarium
Il y a ici volonté d’imiter le langage parlé.
Et au moment où, parvenus sur la terrasse, leur regard se perdit d’un coup au-delà de la palmeraie, dans l’horizon immense, il sembla à Janine que le ciel entier retentissait d’une seule note éclatante et brève dont les échos peu à peu remplirent l’espace au-dessus d’elle, puis se turent subitement pour la laisser silencieuse devant l’étendue sans limites.
Camus, L’Exil et le Royaume




























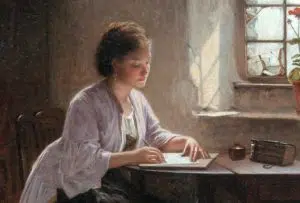









« Appelle-moi Claude Mc le mauvais élève, appelle-moi le cancre
Mais pour la veuve et l’orphelin il faudrait lever l’ancre »
(Avec Les Loups – Mc Solaar)
1-Cher Adrian, le privatif est constitué du seul ‘A’, mais dans le cas présent, nous nous trouvons devant un autre ‘A’ d’où le ‘N’ pour faire la liaison. Mais le ‘A’ peut etre aussi copulatif comme dans notre cas présent, ainsi nous avons: AKOLOUTHOS avec le ‘A’ copulatif puisqu’il dérive de Keleuthos: chemin, voyage, d’où: voyage ensemble ou avec( espérons en bonne compagnie). Puis ANAKOLOUTHOS, avec le ‘A’ privatif e le ‘N’ pour la liaison donc nous aurons: qui ne voyage pas ensemble (c’est peut-etre mieux!). Pour faire bref, Cohérent et Incohérent. Du pareil au meme pour Anantapodotos, qui vient de ‘Antapodosis, d’où: qui est mis en relation, le ‘A’ ici est copulatif, mais le premier ‘A’ est privatif avec le ‘N’ de liaison. Nous avons ainsi comme vous avez déjà et si bien exposé, Adrian, qui manque une mise en relation. Personellement, je ne trouve pas un lien puissant entre l’un et l’autre, mais! Moi par contre je manque d’exemple, sauf un qui peut ne pas entre etre un mais c’est une phrase qui me fait trop rire, car on ne s’attend aucunement à la fin. Elle est de Woody Allen qui veut paraphraser un verset du prophète Isaie:” UN JOUR VIENDRA, LE LOUP DORMIRA AVEC L’AGNEAU, MAIS L’AGNEAU NE DORMIRA PAS LONGTEMPS!” Merci Adrian. monique
Une autre:
“La servante au grand cœur dont vous étiez jalouse
Et qui dort son sommeil sous une humble pelouse
Nous devrions pourtant lui porter quelques fleurs…” (Baudelaire)