Le Code civil des Français, le premier code juridique de la modernité libérale, promulgué le 21 mars 1804 par Napoléon Ier (1804 – 1815), entérine les acquis de la Révolution, mais il consacre en même temps l’incapacité juridique de la femme mariée, et confine la femme dans un état de minorité. Il légalise l’infériorité féminine (Yannick Ripa).
L’incapacité juridique de la femme mariée dans le Code civil de 1804

Les articles ci-dessus ont été modifiés depuis.
Article 213, le plus important d’entre eux, en vigueur jusqu’en 1938 :
Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari.
L’article 212 dit pourtant :
Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.
Article 214 :
La femme est obligée d’habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider : le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.
Article 215 :
La femme ne peut ester en jugement [soutenir une action en justice] sans l’autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens.
La femme est traitée en majeure pour ses fautes (voir l’article 10 de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d’Olympe de Gouges). Article 216 :
L’autorisation du mari n’est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police.
La femme ne peut bénéficier de ses propriétés (droit naturel et imprescriptible de l’Homme selon l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789) sans le consentement du mari, même sous un régime de séparation des biens. Article 217 :
La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l’acte, ou son consentement par écrit.
Cet article est à rapprocher de l’article 1421 :
Le mari administre seul les biens de la communauté. Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme.
Et de l’article 1124 :
Les incapables de contracter sont,
Les mineurs,
Les interdits,
Les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi,
Et généralement tous ceux auxquels la loi a interdit certains contrats.
Seules les marchandes publiques peuvent contracter pour leur négoce sans l’autorisation du mari (article 220). Les femmes peuvent en outre rédiger leur testament sans l’autorisation de leur mari (article 226).
Jusqu’en 1907, la femme mariée ne peut bénéficier librement de son salaire.
Le durcissement de l’accès au divorce
Les conditions du divorce, très libéral à son introduction par la Révolution, et qui s’était révélé être un instrument d’émancipation féminine, sont durcies. François Ronsin parle, dans Les Divorciaires (1992), de “divorce-sanction”.
Le divorce pour incompatibilité d’humeur est supprimé. Les motifs de divorce pour faute sont réduits à trois :
- L’adultère (articles 229 et 230) ;
- les excès, sévices ou injures graves de l’un envers l’autre (article 231) ;
- la condamnation de l’un des époux à une peine infamante (article 232).
Cependant, le divorce pour adultère est inégal, puisque l’homme peut divorcer pour n’importe quel adultère, alors que la femme doit subir une espèce de bigamie de fait.
Article 229 :
Le mari peut demander le divorce pour cause d’adultère de sa femme.
Article 230 :
La femme peut demander le divorce pour cause d’adultère de son mari, lorsqu’il aura tenu sa concubine dans la maison commune.
Selon l’article 324 du Code pénal de 1810, l’époux peut même tuer sa femme en cas d’adultère :
Néanmoins, dans le cas d’adultère, prévu par l’article 336, le meurtre commis par l’époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, à l’instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable.
Qui plus est, l’adultère de la femme peut être puni par une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans (article 337 du Code pénal de 1810), alors que celui de l’homme est seulement passible d’une amende.
Les conditions du divorce par consentement mutuel sont de surcroît rendues très contraignantes :
- sur l’âge:
- Article 275 : “Le consentement mutuel des époux ne sera point admis, si le mari a moins de vingt-cinq ans, ou si la femme est mineure de vingt-un ans.”
- Article 277 : “il [le consentement mutuel] ne pourra plus l’être après vingt ans de mariage, ni lorsque la femme aura quarante-cinq ans.”
- sur la durée :
- Article 276 : le consentement mutuel ne sera admis qu’après deux ans de mariage.
- Article 277 : et plus après vingt ans de mariage.
- Les mariés souhaitant divorcer doivent obtenir l’autorisation des pères et mères, ou des autres ascendants vivants (article 278).
- Ils doivent passer par quatre tentatives de conciliation (article 285 et 286).
- Ils ne pourront se remarier avant trois ans après le divorce (article 297).
En outre, dans le cas du divorce par consentement mutuel, “la propriété de la moitié des biens de chacun des deux époux sera acquise de plein droit, du jour de leur première déclaration, aux enfants nés de leur mariage […]” (article 305).
Le divorce est finalement interdit en 1816, pour n’être rétabli qu’en 1884. Mais le consentement mutuel n’est de nouveau légalisé qu’en 1975.
L’autorité paternelle exclusive
Art 373 :
Le père seul exerce cette autorité [l’autorité paternelle] durant le mariage
Article 374 :
L’enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n’est pour enrôlement volontaire, après l’âge de dix-huit ans révolus.
L’enfant ne peut contracter de mariage sans le consentement du père et de la mère, mais en cas de dissentiment, le consentement du père suffit (article 148).
Le père est en outre protégé des enfants nés hors mariage (les enfants naturels). La femme non mariée et son enfant ne peuvent bénéficier d’une indemnité ou d’une pension alimentaire, ou poursuivre le père pour les obtenir (Ute Gerhard). Article 340 (issu du décret du 2 novembre 1793) :
La recherche de paternité est interdite […]
L’enfant naturel reconnu par son père, considéré comme illégitime, ne peut réclamer les droits d’enfant légitime (article 338). En outre, la reconnaissance ne peut avoir lieu pour un enfant né de l’adultère (article 335).
Le Code pénal de 1810 incrimine en outre l’avortement :
Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, violences, ou par tout autre moyen, aura procuré l’avortement d’une femme enceinte, soit qu’elle y ait consenti ou non, sera puni de la réclusion.
La même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procuré l’avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet, si l’avortement s’en est ensuivi.
Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où l’avortement aurait eu lieu.
Une infériorité légale au magistrat domestique
La femme n’est pas une personne juridique indépendante. C’est une mineure. Elle est placée, comme les enfants, sous la puissance maritale. C’est un être réduit à la sphère domestique, qui n’est pas appelé à vivre en public, son rôle se réduisant à celui d’épouse et mère.
Il faut que la femme sache qu’en sortant de la tutelle de sa famille, elle passe sous celle de son mari.
Napoléon Bonaparte (Cité par Leila Saada)
Selon Yannick Ripa :
Aux yeux de Napoléon Bonaparte, marqué par la mentalité méridionale, les femmes sont des êtres inférieurs, soumises en tant qu’épouses, respectables en tant que mères.
Cette configuration de la famille sert la société d’ordre, hiérarchisée, que cherche à devenir l’Empire napoléonien pour stabiliser la Révolution :
La famille est comme l’État bonapartiste. À sa tête, un chef tout-puissant règne sur ses sujets.
Jacques-Olivier Boudon, Citoyenneté, République et Démocratie en France
La femme célibataire est, elle, marginalisée.
La misogynie des rédacteurs du Code civil
L’obéissance de la femme est un hommage rendu au pouvoir qui la protège […]
Dans un article publié dans la revue Droits en 2005, l’historien Xavier Martin (né en 1945), qui semble hostile à la pensée des Lumières et des révolutionnaires, tente d’expliquer, à partir de l’œuvre des auteurs de courant, une des sources intellectuelles de la Révolution, la misogynie des rédacteurs du Code civil.
Selon Xavier Martin, la source de cette misogynie se trouverait dans le scientisme des Lumières “en rupture militante avec les vues chrétiennes sur la nature humaine”, selon lequel la notion d’homme ne s’appréhenderait que par sa capacité sensorielle, et dans le refus de concevoir, toujours en rupture avec la tradition chrétienne, l’homme à l’image de Dieu.
Les penseurs des Lumières ou leurs héritiers auraient déduit des différences de capacité sensorielle la distance qui séparerait l’homme de la femme.
Dans une note restée célèbre de Qu’est-ce que la propriété ? (1840), le penseur socialiste Pierre-Joseph Proudhon (1809 – 1865) écrit ainsi :
L’homme et la femme ne vont pas de compagnie. La différence des sexes élève entre eux une séparation de même nature que celle que la différence des races met entre les animaux.
Selon Xavier Martin, pour les principaux philosophes des Lumières, penser se réduirait à sentir. Or, selon ces mêmes penseurs (sauf peut-être Diderot), la femme serait mal équipée dans cette capacité qui fait l’intelligence humaine. Elle serait esclave de la tyrannie des sensations, une capacité de sentir exacerbée qui la rendrait à la fois plus vive mais moins capable de se fixer sur des objets pour les penser. L’Encyclopédie (1751 – 1772) dit ainsi à l’entrée “Femme” :
Si cette même délicatesse d’organes qui rend l’imagination des femmes plus vive, rend leur esprit moins capable d’attention, on peut dire qu’elles aperçoivent plus vite, peuvent voir aussi bien, regardent moins longtemps.
Ce sont des “machines qui n’ont jamais fait que sentir”.
Par une espèce de division du travail naturelle, l’homme serait seul apte à l’abstraction, et la femme devrait appliquer les principes que l’homme tirerait de ses méditations :
La recherche des vérités abstraites et spéculatives, des principes, des axiomes dans les sciences, tout ce qui tend à généraliser les idées n’est point du ressort des femmes, leurs études doivent se rapporter toutes à la pratique ; c’est à elles à faire l’application des principes que l’homme a trouvés, et c’est à elles de faire les observations qui mènent l’homme à l’établissement des principes.
Voltaire écrit dans la même veine :
Sa force est presque toujours supérieure ; il est plus agile ; et, ayant tous les organes plus forts, il est plus capable d’une attention suivie. Tous les arts ont été inventés par lui, et non par la femme. On doit remarquer que ce n’est pas le feu de l’imagination, mais la méditation persévérante et la combinaison des idées, qui ont fait inventer les arts, comme les mécaniques, la poudre à canon, l’imprimerie, l’horlogerie, etc.
Dictionnaire philosophique, Entrée “Homme”
La femme pour Portalis, serait immature :
Chez les femmes surtout, on doit s’attendre à une plus grande variété de goûts et à une multitude de petits caprices incessants
Conséquence de cette immaturité, la femme serait trop généreuse, tare qu’elle partagerait avec le sauvage. Elle serait ainsi incapable de gérer un patrimoine, car trop susceptible de s’appauvrir, et moins capable de faire régner l’ordre parmi les siens.
Au XIXe siècle, Auguste Comte (1798 – 1857) énonce, dans son Cours de philosophie positive, le projet scientifique de démonstration de l’infériorité de la femme immature, enfermée “dans une sorte d’état d’enfance continue” :
Déjà la saine philosophie biologique, surtout après l’importante théorie de Le Gall, commence à pouvoir faire scientifiquement justice de ces chimériques déclamations révolutionnaires sur la prétendue égalité des deux sexes, en démontrant directement, soit par l’examen anatomique, soit par l’observation physiologique, les différences radicales, à la fois physiques et morales, qui, dans toutes les espèces animales, et surtout dans la race humaine, séparent profondément l’un de l’autre, malgré la commune prépondérance du nécessaire du type spécifique. Rapprochant, autant que possible, l’analyse des sexes de celles des âges, la biologie positive tend finalement à représenter le sexe féminin, principalement chez notre espèce, comme nécessaire constitué, comparativement à l’autre, en une sorte d’état d’enfance continue, qui l’éloigne davantage, sous les plus importants rapports, du type idéal de la race.
La marginalisation des femmes aurait été d’autant plus forte que la France aurait eu pour réputation d’être un pays “féminin”, un peuple dont le caractère instable, dont les idées mobiles, devraient être conjurées.
À lire
- Jacques-Olivier Boudon, Citoyenneté, République et Démocratie en France, Chapitre 3 : La République consulaire, 2014
- Alain Desreynaud, Le père dans le Code civil, un magistrat domestique, Revue Napoleonica, La Revue, 2012/2 (n°14)
- Ute Gerhard, Droit civil et genre dans l’Europe au XIXe siècle, Revue Clio. Femmes, Genre, Histoire, 2016/1 (n°43)
- Dominique Godineau, Les Femmes dans la France moderne, XVI-XVIIIe siècle, Chapitre 9 – La Révolution : citoyennes sans citoyenneté
- Anne Lefebvre-Teillard, La famille, pilier du Code civil, Revue Histoire de la justice, 2009/1 (n°19)
- Xavier Martin, Misogynie des rédacteurs du Code civil : une tentative d’explication, Revue Droits, 2005/1 (n°41)
- Yannick Ripa, Les femmes, actrices de l’histoire France, de 1789 à nos jours, Chapitre 3 – Le xix e siècle : le renforcement de la différence des sexes, 2010
- Leila Saada, Les interventions de Napoléon Bonaparte au Conseil d’État sur les questions familiales, Napoleonica. La Revue 2012/2 (n°14)









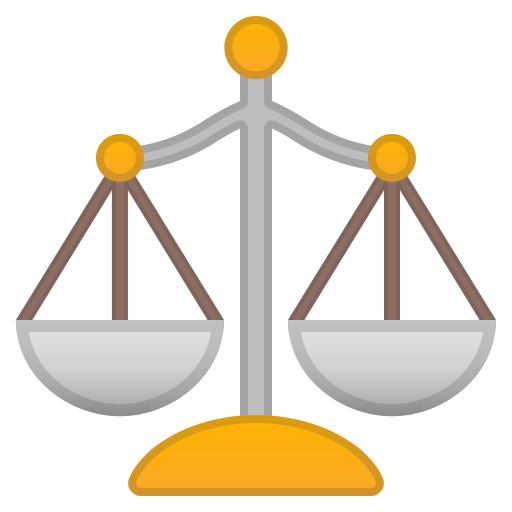









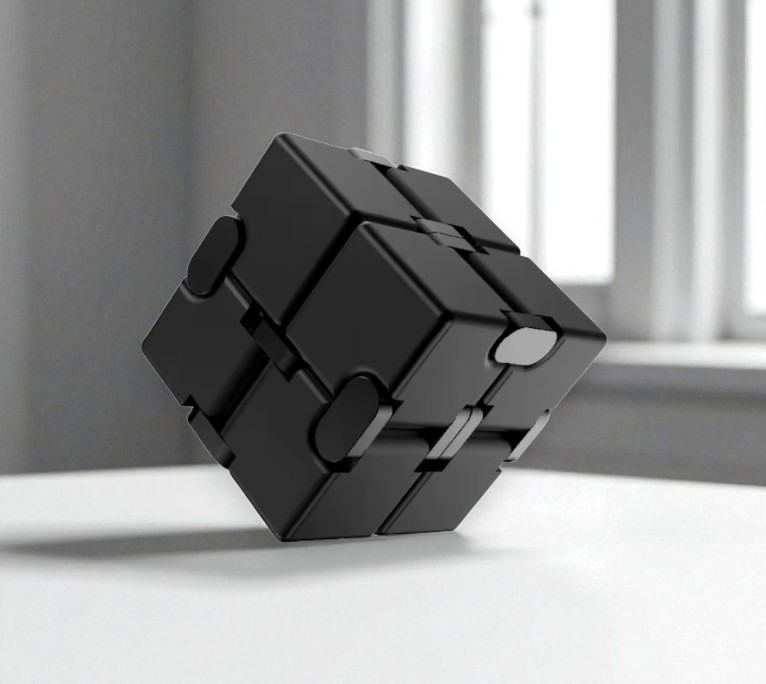

















Gn II, 18: L’Éternel Dieu dit:” Il n’est pas bon que l’homme soit seul/solitaire; je lui ferai un(e) auxiliaire en face de lui/ en accord avec lui.” Finalement, Adrian, le meilleur, le plus respectueux et le pas mysogine ‘législateur’ qui soit, c’est Dieu, suivant ce texte fondateur, car ce verset démontre que la femme, puisqu’il s’agira d’Éve, n’est ni sous l’homme, ni en désaccord avec l’homme, au départ!et last but not least, c’est en fait la femme qui protège l’Homme et pas le contraire puiqu’elle l’aide, nous irons jusqu’à dire qu’à ce point, et’ à la lettre’ c’est plutôt l’homme qui a besoin de la femme et non/pas vice verca (aidez-moi sur le pas ou non, Adrian!). Suivant mon interprétation, si je peux me permettre, en partant de ‘la lettre’, cette histoire ne doit pas plaire du tout à l’homme, et c’est pourquoi il a tout fait et combien défait pour soumettre les descendantes d’Éve. C’est humain! mais combien inhumain. Merci Dieu! Merci, Adrian. monique
Comme c’est facile de vouloir porter un jugement sur les rédacteurs du code civil en se basant sur un système de valeurs complètement différent. Ce genre de critique existe aussi aux Etats-Unis (en fait dans tout le monde dit occidental), où on préfère insister sur l’idéologie esclavagiste des fondateurs de la nation. Utiliser des termes comme “misogynie” avec la connotation dégradante qu’on y associe de nos jours est une tentative de discréditer les philosophes et les Grands Hommes qui ont bâti la société moderne, surtout après le chaos que la Révolution a laissé.
Il ya aussi cette critique des Lumières et du scientisme qui n’est pas objective. Dans les départements des nouvelles sciences humaines (études du genre, études raciales ou post coloniales), la déconstruction est l’outil de prédilection. On accuse aujourd’hui les Lumières d’être responsables du colonialisme, de toutes les atrocités du XX siècle, des “privilèges” de l’homme blanc. Cette critique n’est pas faite par des hommes de religion ou des réactionnaires mais bien par des intellectuels laïcs qui comprennent l’importance de la rigueur scientifique mais qui n’ont aucun scrupule à la remettre en cause si cela peut bien servir les intérêts d’une idéologie visant à lutter contre des “oppressions” virtuelles ou réelles.
Je pense que l’auteur de cet article aurait dit s’en tenir aux faits et ne pas porter de jugement moraliste sur l’époque.
L’article en soi, dépouillé du style post moderne, est excellent et très enrichissant.