Orthographe
On écrit plutôt : sens dessus dessous. C’est la forme enregistrée par les dictionnaires usuels (Dictionnaire de l’Académie française, le Robert, le Larousse ou le TLF).
Exemples
- Après la fête, la maison s’était retrouvée sens dessus dessous.
- Personne ne comprenait plus rien à rien, la situation était complètement sens dessus dessous.
- « La ville est sens dessus dessous. Les boutiques se ferment. Les femmes font à la hâte leurs provisions, les rues se dépavent, tous les cœurs sont serrés par l’angoisse d’un grand événement. Le pavé sera prochainement inondé de sang. » (Baudelaire, L’Art romantique)
- « […] des morceaux de mansardes avec leur papier peint, des châssis de fenêtres avec toutes leurs vitres plantés dans les décombres, attendant le canon, des cheminées descellées, des armoires, des tables, des bancs, un sens dessus dessous hurlant, et ces mille choses indigentes, rebuts même du mendiant, qui contiennent à la fois de la fureur et du néant. » (Hugo, Les Misérables)
Vous devez cliquer ici pour lire l’article : « autant pour moi » ou « au temps pour moi » ?
« Sens dessus dessous » et « sans dessus dessous » : des variantes ?
Cette locution signifie « dans un grand désordre, dans un état de grande confusion, bouleversé, pêle-mêle ». Selon l’Académie française, cette locution s’écrivait à l’origine « ce en dessus dessous » puis « cen dessus dessous ». Sa signification était « ce qui doit être dessus se retrouve dessous ». En d’autres termes, les choses sont en désordre total.
Cependant, l’usage a longtemps varié sur la graphie de cette locution et on ne saurait considérer « sans dessus dessous » comme une faute. C’est plutôt une variante. Ainsi, le grammairien du XVIIe siècle Vaugelas (1585 – 1650), législateur influent de l’orthographe française, préférait la forme avec « sans ». On trouve cette version chez Voltaire (16694 – 1778) par exemple :
J’ai voyagé, j’ai vu du tintamarre ;
Je n’ai jamais vu semblable bagarre ;
Tout le logis est sans dessus dessous.
Jules Verne (1828 – 1905) publie en outre, en 1889, un roman intitulé Sans dessus dessous. Balzac (1799 – 1850), dans son œuvre, préfère la forme originelle. Il dit d’ailleurs, dans la Revue parisienne d’août 1840 :
Je m’obstine à orthographier ce mot comme il doit l’être. Sens dessus dessous est inexplicable. L’Académie aurait dû, dans son Dictionnaire, sauver au moins dans ce composé, le vieux mot cen qui veut dire : ce qui est.
Il est confirmé dans cette opinion par le Littré pour qui « la vraie locution est donc c’en devant derrière, c’en dessus dessous ». Autres exemples :
J’aurois fait le Samson dans ma fureur extrême ;
J’aurois mis ton château tout sans dessus dessous, (Scarron, Don Japhet d’Arménie, 1653)« […] et des mois n’auraient pas suffi à cette tâche, car ces vitres avaient été maintes fois réparées et replacées souvent sans dessus dessous, de telle sorte qu’il devenait malaisé de les lire. » (Huysmans, La Cathédrale)
Cette variante reste rare dans les écrits anciens (environ 14 300 résultats sur Gallica pour la forme en « sens », environ 2400 pour celle en « sans »), mais elle est plutôt courante aujourd’hui avec la multiplication des écrits que permet internet (plus de 800 000 pour la forme en « sens » sur Google, et tout de même 377 000 pour la forme en « sans »).































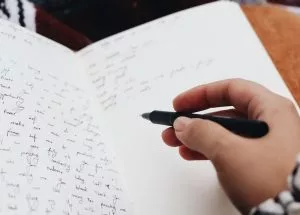





Laisser un commentaire