On écrit : carrousel.Deux « r », un seul « s ». On prononce ce mot « carrouzel », bien qu’on ait souvent tendance à la prononcer « caroussel » (voir ici : 55 mots que l’on « ne sait pas » prononcer).
Ce qu’il faut retenir
-
Deux « r », un « s » : carrousel uniquement. Exemple : manège forain.
-
Vient du napolitain carusello, jeu équestre espagnol. Exemple : tournois médiévaux.
-
Erreur fréquente : caroussel par surinterprétation phonétique. Exemple : son [s].
-
Mnémotechnique : carrousel comme carrosse, même gémination « r ». Exemple : étymologie.
-
Usage moderne : politique, technologie, architecture. Exemple : carrousel ministériel.
Les erreurs d’orthographe les plus fréquentes
Cette confusion orthographique touche de nombreux francophones. Pourquoi cette hésitation persistante ? La réponse réside dans notre perception auditive du mot.
La graphie erronée « caroussel » provient d’une surinterprétation phonétique. Nous entendons le son [s] final et pensons logiquement qu’il faut doubler cette consonne. Cette logique, bien que compréhensible, nous induit en erreur.
Ce mot vient du napolitain carusello (carosello en italien), nom d’un jeu introduit à Naples par les Espagnols dans lequel des groupes de cavaliers se lançaient des balles de craie en forme de tête (il est dérivé de caruso : « tête rasée »). Ce jeu aurait été d’origine mauresque. « Carrousel » a été introduit en français avec deux « r » (d’abord sous la forme carrouselles au XVIe siècle) sous l’influence de « carrosse » (cf. Dictionnaire historique de la langue française), car il désignait autrefois des tournois de chevaliers caractérisés par la diversité des livrées et des habits et organisés à l’occasion d’une fête.
L’évolution sémantique du terme
L’histoire de ce mot révèle une transformation remarquable. Du tournoi médiéval au manège forain, le carrousel a conservé son essence : le mouvement circulaire.
« Les premiers carrousels français du XVIIe siècle rassemblaient jusqu’à 200 cavaliers dans des spectacles équestres grandioses. »
Cette évolution sémantique explique pourquoi nous retrouvons aujourd’hui ce terme dans des contextes si variés. Du carrousel publicitaire aux carrousels d’images sur internet, la notion de rotation demeure centrale.
Par analogie, on a nommé « carrousel » les manèges de chevaux de bois. Au reste, carousel (un seul « r ») signifie « manège » en anglais (ainsi que le tapis sur lequel roulent les bagages à l’aéroport).
Comparaison internationale des graphies
| Langue | Orthographe | Prononciation |
|---|---|---|
| Français | carrousel | [kaʁuzɛl] |
| Anglais | carousel | [ˌkærəˈsel] |
| Italien | carosello | [karoˈzello] |
| Espagnol | carrusel | [karuˈsel] |
Cette comparaison révèle une constante linguistique : toutes les langues ont adapté ce terme selon leurs règles phonétiques propres. Le français a choisi de conserver les deux « r » par analogie avec « carrosse ».
Par métonymie, un carrousel est une succession rapide de choses ou de personnes (synonymes : ronde, valse). La place du Carrousel à Paris tient son nom d’un grand spectacle équestre du même nom organisé par Louis XIV en 1662 pour fêter la naissance du Dauphin. L’arc a été bâti sous Napoléon Ier.
Règles mnémotechniques pour retenir l’orthographe
Comment ne plus jamais se tromper ? Voici des astuces infaillibles :
« CarrouSEL comme carrOSSE : deux R, un S. »
Vous pouvez également associer carrousel à d’autres mots de la même famille étymologique. Le lien avec « carrosse » n’est pas fortuit : ces deux termes partagent cette gémination du « r ».
Une autre technique consiste à visualiser le mouvement rotatif. Les deux « r » rappellent cette rotation continue, tandis que le « s » unique évoque la fluidité du mouvement.
Contextes d’utilisation modernes
Aujourd’hui, « carrousel » s’emploie dans quatre domaines principaux :
- Architecture urbaine : Place du Carrousel, rond-point du Carrousel
- Technologie : carrousel d’images, carrousel publicitaire
- Politique : carrousel ministériel, carrousel des nominations
- Loisirs : carrousel forain, carrousel équestre
Chaque contexte conserve cette notion de succession organisée. Que ce soit dans le domaine numérique ou politique, le carrousel implique toujours un retour cyclique au point de départ.
Vérifiez votre orthographe
En cas de doute sur l’orthographe de ce mot ou d’autres termes, n’hésitez pas à utiliser notre correcteur d’orthographe pour vous assurer de la justesse de vos écrits.
Exemples avec « carrousel »
- Louis XIV amusait sa noblesse en organisant des fêtes et des carrousels somptueux.
- Le carrousel des
ministres témoignait de l’instabilité du gouvernement.
- on pourrait aussi écrire « la ronde des ministres ».
- Il y avait dans mon enfance, à Dijon, un vieux carrousel dans lequel je voulais toujours monter.
- Les touristes avaient rendez-vous avec leur guide sous l’arc du triomphe du Carrousel, devant le Louvre, à Paris.
- Parfois, le vieil homme s’asseyait sur un banc et se plongeait dans un carrousel de souvenirs qui lui faisaient regretter le temps si vite passé.
Exemples dans des contextes contemporains
« Le carrousel publicitaire de ce site web propose une navigation intuitive entre les différents produits. »
« Ce carrousel politique incessant fatigue les citoyens qui aspirent à plus de stabilité. »
Ces exemples modernes démontrent la vitalité linguistique du terme. Carrousel s’adapte parfaitement aux réalités technologiques contemporaines tout en conservant son sens originel.
La règle est simple : carrousel s’écrit toujours avec deux « r » et un « s ». Cette orthographe unique s’applique dans tous les contextes, qu’ils soient historiques, technologiques ou métaphoriques.


































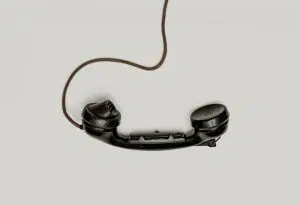


On prononce « carrouzel » parce que un « s » entre 2 voyelles se prononce toujours « z » !